Vous trouverez sur cette page, amis lecteurs, mes anciennes critiques et avis divers parues sur mon blog Ecranlarge.com. Elles n'ont pas de classement particulier si ce n'est par ordre de
visionnage. Elles sont indexées sur le moteur de recherche en page d'accueil de mon site. Bonne lecture à tous !
Ratatouille (2007) de Brad Bird
 La fatalité a du bon chez Pixar. A
la pensée déterministe qui parsème le dernier long métrage de Pixar fait écho l’incroyable destinée de ce studio californien jadis chapeauté par Monsieur Apple. Le sort de Pixar fait des envieux.
Alors que ses concurrents – Dreamworks Pictures - connaissent des chemins plus sinueux, les réalisations pixariennes se suivent et se ressemblent : la fortune sourit à chaque
nouvelle sortie. Ce succès reconduit est le fruit d’une remarquable régularité qualitative plus que d’une destinée hasardeuse et chanceuse. L’esprit du studio est celui de ses personnages de
fiction : c’est à la sueur de son labeur que se mesurent les résultats. A l'inverse de la définition traditionnelle, le déterminisme chez Pixar n’est que le produit de l’action personnelle
employée pour réussir. Il n'y a de déterminisme que celui choisi, et conduit par l'homme. Pragmatique les Pixar’s men ?
La fatalité a du bon chez Pixar. A
la pensée déterministe qui parsème le dernier long métrage de Pixar fait écho l’incroyable destinée de ce studio californien jadis chapeauté par Monsieur Apple. Le sort de Pixar fait des envieux.
Alors que ses concurrents – Dreamworks Pictures - connaissent des chemins plus sinueux, les réalisations pixariennes se suivent et se ressemblent : la fortune sourit à chaque
nouvelle sortie. Ce succès reconduit est le fruit d’une remarquable régularité qualitative plus que d’une destinée hasardeuse et chanceuse. L’esprit du studio est celui de ses personnages de
fiction : c’est à la sueur de son labeur que se mesurent les résultats. A l'inverse de la définition traditionnelle, le déterminisme chez Pixar n’est que le produit de l’action personnelle
employée pour réussir. Il n'y a de déterminisme que celui choisi, et conduit par l'homme. Pragmatique les Pixar’s men ?
Le rationalisme a du bon, surtout lorsqu’il est utilisé pour déterminer les ressorts essentiels qui concourent à la qualité d’un film. Un grand nombre de metteurs en scène se perdent dans les outils technologiques et oublient l’essentiel : quelle est la grammaire cinématographique à utiliser ? Les petits gars de Pixar n’ont pas perdu à l’esprit l’importance du langage de l’image et de ses codes qui vont être lus et analysés par le spectateur. Ce n’est pas tant l’enveloppe charnelle du film qui pèse que son lien avec le spectateur. Autrement dit, le technicien laisse place à l’artiste, et non l’inverse (Qui a parlé de George Lucas ?) L’image de synthèse n’a pas bouleversé le principe et le fonctionnement du film d’animation. Ratatouille en est une nouvelle démonstration. Le film réutilise des éléments qui n’ont rien d’inédit, mais qui, par un savant dosage de vieux et de nouveau, donnent au récit un fort pouvoir de captivité. En contre-plongée devant une vitrine de magasin par tant d’orage, on se croirait chez Basile, le détective privé ; tandis qu’avec la bonhomie de Gusteau et la nostalgie des écriteaux d’un certain « vieux » Paris, on se croirait dans le Montmartre de Jean Pierre Jeunet. Mais l’illusion est parfaite et l’idéalisation parisienne factice. Si le petit rat gastronome a tous les traits du self-made man flamboyant, fidèle à l’image - vendue depuis un siècle par l’iconographie américaine - du parfait inconnu devenu riche et célèbre, il vit dans un monde gastronomique sombre et impitoyable. Ce n’est pas le critique Ego qui nous contredira : cachexique et replié dans son univers gothique, il est tout droit sorti de chez Tim Burton. Ratatouille pourrait être la démonstration américaine qu’il n’y a de fatalité que pour ceux qui ne s’en donnent pas la peine. Mais comme tout est plus complexe et moins facile dans la réalité, Brad Bird a résolument choisi d’y mettre de la nuance, tout en évitant de sombrer dans un certain pessimisme démissionnant. Bah oui, il faut quand même que les petits bambins gardent le sourire…
Que cette fatale réussite pixarienne se renouvelle à la hauteur de ce qu’elle a engendré pour ce Ratatouille. C’est tout le malheur que l’on souhaite au prochain Wall-E prévu pour 2008.
INLAND EMPIRE (2007) de Maître David Lynch
 Comprendre, c'est chercher à
expliquer. La plupart des activités humaines font de la connaissance et de la recherche de la vérité un défi à la mesure du gigantisme même de l'humanité. Cette quête des parcelles de vérité est
le propre des sciences, qu'elles soient dures (exactes) ou "molles" (inexactes). L'art en général est un domaine encore plus "mou", puisqu'il n'est régit que par des règles que l'on veut bien lui
donner - a posteriori. La "loi" artistique si illégitime soit-elle, ne peut pas être le résultat et le point de départ d'une recherche scientifique. De plus, il existe autant de "lois"
artistiques qu'il existe de cinéastes, au contraire de la science, qui cherche à exposer la cognition universelle. Dès lors, peut-on expliquer un film et même le comprendre, ou s'agit-il
avant tout de l'appréhender, et de présenter - même de manière organisée - les thèmes du film ?
Comprendre, c'est chercher à
expliquer. La plupart des activités humaines font de la connaissance et de la recherche de la vérité un défi à la mesure du gigantisme même de l'humanité. Cette quête des parcelles de vérité est
le propre des sciences, qu'elles soient dures (exactes) ou "molles" (inexactes). L'art en général est un domaine encore plus "mou", puisqu'il n'est régit que par des règles que l'on veut bien lui
donner - a posteriori. La "loi" artistique si illégitime soit-elle, ne peut pas être le résultat et le point de départ d'une recherche scientifique. De plus, il existe autant de "lois"
artistiques qu'il existe de cinéastes, au contraire de la science, qui cherche à exposer la cognition universelle. Dès lors, peut-on expliquer un film et même le comprendre, ou s'agit-il
avant tout de l'appréhender, et de présenter - même de manière organisée - les thèmes du film ?
Cette croyance en la compréhension d'un film provient d'un amalgame généralement admis parmi la population : on comprend un film dès lors que l'on suit son histoire. L'existence d'une histoire, si logique soit-elle dans son déroulement, n'induit pas forcément la mise en compréhension. Elle dépend surtout de la didactique même de l'auteur, qu'elle soit filmique ou verbale. Alors faut-il en conclure qu'il n'existerait qu'un cinéma purement narratif, apparenté à de la littérature filmée ? Sans vouloir fâcher les amoureux des mots et de la langue, il serait absurde de vouloir résumer le septième art à cette forme de production.
INLAND EMPIRE déboute cette croyance. Que ce soit par son procédé ou par son sujet, INLAND EMPIRE n'est pas une
oeuvre qui se déploie à la manière d'une narration. L'histoire n'est pas le récit, mais l'adéquation, la juxtaposition de données très hétérogènes qui par leur seule illustration à l'écran
évoquent une histoire. Ce n'est pas une équation, puisqu'il n'y a rien à résoudre, mais l'assemblage de données antinomiques, qui peuvent être renverser dans le même champ sans que cela affecte
le déroulement du film. (1 + x + 8 + Y plutôt que 1,2,3,4). Autrement dit, le film est guidé dans sa construction et dans sa présentation à l'écran non pas par les lignes de script, de dialogues,
mais par l'image elle-même. Le film ne se suit pas à la manière d'un fil, mais s'arpente, dès lors que les scènes posées dans un ordre aléatoire n'affecte pas l'ensemble. INLAND
EMPIRE perfectionne ce principe de cinéma non-narratif en montrant que la composition même de l'image est à même de donner un procédé "narratif". Une certaine "histoire" peut se dessiner
avec ou sans les dialogues.
INLAND EMPIRE confirme que le cinéma de Lynch est avant tout affaire de néo-expressionisme. Un cinéma de l'intérieur, un art
qui exprime les ressentis et le Inland des individus. A l'instar des plus grands muets allemands du début du XXe siècle, l'image et la composition des plans (Position des personnages
dans le champ de la caméra, expressions des faciès accentués, plans rapprochés et disproportionnés) offrent au spectateur une vision du monde qui à elle seule peut s'affranchir du procédé
narratif, d'un récit. D'aucuns parlent du rôle fondamental du son dans les films de Lynch. Le son est utilisé comme l'instrumentation des films muets : une bande son qui peut être changée,
déplacée au fil des scènes sans que cela affecte réellement leur efficacité scénaristique. Le son ne doit pas être seulement un moyen de rebondir. Il peut ne pas être un élément de découpage du
script et du rythme même du film. Si la texture sonore de INLAND EMPIRE confère une ambiance, celle-ci celle-ci ne dépend ni du son, ni du texte. Ainsi, par l'image,
INLAND EMPIRE serait un film ne souffrant pas de la scricte irréversibilité des films à structure narrative.
Outre le procédé, le propos de David Lynch tend vers la même idée. Il est très surprenant de constater que le film s'ouvre sur le thème de l'obsession du script ainsi que son contenu alors même que - a priori - lors de sa construction, il en est presque dépourvu. La place du personnage de Nikki, son interrogation sur son existence, sur ce qui est ou ce qui serait sa vie, renvoie directement au scénario et à l'idée d'emprisonnement. Le personnage est-il bridé par l'écriture ? La vie ne serait-elle pas une succession d'éléments singuliers dont il est difficile de relier ? L'assemblage de ces bouts par l'écriture réduirait-il une complexité qui finalement, est inaccessible ?
Si jusqu'à présent David Lynch jouait constamment de l'opposition entre cruauté et sensualité des hommes et du monde, dans INLAND
EMPIRE, il n'a que faire de la nécessité d'être un dyptique où la noirceur est tempérée par la naïveté. A la beauté plastique des plans de Twin Peaks : Fire walk with me
ou de Mulholland drive substitue la laideur de l'image numérique de INLAND EMPIRE. La caméra filme avec désespoir et suit non sans complaisance, mais avec
beaucoup d'hésitation, l'horreur de Nikki/Suzanne. Certes, INLAND EMPIRE est une oeuvre radicale et éprouvante. Le film ne cherche pas à répondre aux désirs du spectateur. Il ne
s'agit ni de démontrer ni d'initier. Il n'y a pas d'explication pas plus qu'il y ait une envie d'être didactique dans la manière de représenter la chose. Lynch présente son film sans chercher des
ressorts attractifs qui pourraient nuire à la pureté de son image du monde. En ce sens, INLAND EMPIRE est le rejeton d'une forme de conception de l'art qui s'affranchit des
desiderata du quotidien et des hommes.
Le Dahlia noir (2007) de Brian de Palma
 N’ayons pas peur des mots :
Le Dahlia noir est un naufrage total. On s’attendait à ce que l’auteur de L'impasse transgresse le chef d’œuvre de James Ellroy, quitte à transcender le tout de sa patte
fétiche. Il n’en est rien. Le produit final n’est même pas digne d’un mauvais polar calibré pour un circuit en multiplexes. Quitte à raccourcir ce superbe livre, encore faut-il en conserver la
substantifique mœlle ; celle d’une atmosphère noire comme l’ébène, d’une intensité scénaristique qui tient en haleine son lecteur tout au long des quelques 500 pages de ce joyau de la
littérature américaine. Brian de Palma a été incapable de reconstituer une ambiance si bien que son film est un produit mutant, à mi-chemin entre un polar pulp et un mauvais vaudeville.
L’interprétation est si pénible et enlevée que l’on se croirait chez Resnais - Pas sur la bouche - ou Ozon - 8 femmes. Tantôt constipés, tantôt en surjeu, les différents
protagonistes n’ont aucun charisme. Ils se dévoilent sans mystère. Où sont donc passées les tensions entre les diverses protagonistes, cette intensité des regards que l’on pouvait déchiffrer
entre les lignes du brûlot de Ellroy ?
N’ayons pas peur des mots :
Le Dahlia noir est un naufrage total. On s’attendait à ce que l’auteur de L'impasse transgresse le chef d’œuvre de James Ellroy, quitte à transcender le tout de sa patte
fétiche. Il n’en est rien. Le produit final n’est même pas digne d’un mauvais polar calibré pour un circuit en multiplexes. Quitte à raccourcir ce superbe livre, encore faut-il en conserver la
substantifique mœlle ; celle d’une atmosphère noire comme l’ébène, d’une intensité scénaristique qui tient en haleine son lecteur tout au long des quelques 500 pages de ce joyau de la
littérature américaine. Brian de Palma a été incapable de reconstituer une ambiance si bien que son film est un produit mutant, à mi-chemin entre un polar pulp et un mauvais vaudeville.
L’interprétation est si pénible et enlevée que l’on se croirait chez Resnais - Pas sur la bouche - ou Ozon - 8 femmes. Tantôt constipés, tantôt en surjeu, les différents
protagonistes n’ont aucun charisme. Ils se dévoilent sans mystère. Où sont donc passées les tensions entre les diverses protagonistes, cette intensité des regards que l’on pouvait déchiffrer
entre les lignes du brûlot de Ellroy ?
La mise en scène de de Palma est tout simplement grotesque. Elle piétine dans le kitsch, frise le ridicule à chaque fondu d’un amateurisme à faire sourire plus d’un monteur en culottes courtes. Le récit est laborieux dans son écriture comme dans son déroulement. Ce n’est pas tant les raccourcis à déplorer que la manière dont le cinéaste expédie l’intrigue du film ! A aucun moment le spectateur ne se sent happé par le propos, pris en otage par un récit qui se veut haletant.
Quant à l’accompagnement musical, ne passons pas par quatre chemins : Qui que ce soit le responsable de cette catastrophe, brisez lui les mains ! Sur un air jazzy du plus mauvais effet, la musique rompt totalement avec la tonalité du Los Angeles dessiné par James Ellroy.
Malheureusement pour nous, ce Dahlia noir n’est en rien ce que l’on aurait pu attendre du réalisateur des Incorruptibles Ce polar aseptisé et faussement provocateur démontre une fois n’est pas coutume que la validité d’une adaptation littéraire dépend de la manière dont le cinéaste s’est approprié l’ouvrage. Ont peut ici, s’interroger sur ce rapport.
Les fils de l'homme (2006) de Alfonso Cuaron
 On se croirait chez Terry
Gilliam ou Danny Boyle ; dans l'Armée des douze singes ou dans 28 jours plus tard. Oui, Alfonso Cuaron a réussi le pari fou de réaliser un film d’anticipation inscrit dans
la grande lignée d’un cinéma crépusculaire, le tout, proposé dans un écrin qui laisse admiratif.
On se croirait chez Terry
Gilliam ou Danny Boyle ; dans l'Armée des douze singes ou dans 28 jours plus tard. Oui, Alfonso Cuaron a réussi le pari fou de réaliser un film d’anticipation inscrit dans
la grande lignée d’un cinéma crépusculaire, le tout, proposé dans un écrin qui laisse admiratif.
Le réalisateur d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban offre au spectateur une réflexion crue sur l’actualité. A l’heure où le Sénat américain entérine la proposition de fortifier la ligne de démarcation qui sépare les Etats-Unis du Mexique, le metteur en scène mexicain dénonce froidement la politique sécuritaire et autarcique des pays développés cherchant à protéger délibérément leur pseudo boîte de Pandore, quitte à rompre avec l’idéal démocratique qu’ils vendent chaque jour dans les conférences de presse internationales, et spécialement au Moyen Orient.
Société devenue folle car stérile, l’humanité dans les Fils de l'homme a perdu sa raison de vivre, puisque incapable d’assurer sa reproduction. Cuaron pose son sujet à l’image de Rousseau dans le Contrat social. Il est vain de vouloir esquisser l’étiologie des maux dont souffrent l’humanité, de comprendre le pourquoi de la dégénérescence et l’infertilité de la société humaine – post-industrielle. A l’instar des Discours de Jean-Jacques Rousseau, le film de Cuaron présente une réalité perdue dans la haine du nombre et l’aliénation de la raison au service de la satisfaction de quelques. En ce sens, les Fils de l'homme est le pendant du Nouveau Monde de Terrence Malick, la démonstration d’une déliquescence dont le cinéaste texan et le Genevois se font le parangon. Depuis l’état de nature virginal de l’humanoïde des contrées de Virginie jusqu’à la dépravation de l’homme social incapable de vivre avec ses semblables, il n’y a qu’un pas entre ces deux films où planent l’ombre du philosophe.
Si l’élixir en vaut la peine, que dire du flacon ? La mise en scène des Fils de l'homme est tout à la fois audacieuse et timorée. Le scénario est structuré par un certain nombre de temps forts dont on ignore le sens jusqu’à leurs manifestations. L’objectif par lequel regarde le cinéaste a la qualité de nous épargner par avance les ressorts scénaristiques. La mise en scène a cela de réussie qu’elle laisse une sensation étrange de distance et d’implication. Une façon de se faire oublier, tout en étant sur le qui-vive lorsque le sujet l’y invite. Ainsi, la caméra semble affranchie de ce que lui dicte le script ; elle semble ne pas converger nécessairement avec ce que voudrait montrer la ligne du texte. Que ce soit dans la gestion de l’espace, la portée et les mouvements de la caméra, la réalisation des Fils de l'homme est à la hauteur de ce film somme, nouvel étalon en la matière : impliquée et douce-amère.
Superman returns (2006) de Bryan Singer
 Certains historiens ont
tendance à penser que le cinéma d’Hollywood est intéressant dans sa façon de mettre en valeur les aspirations, les tensions et autres maladies d’une société occidentale hantée par la peur
d’assister à sa déchéance, de perdre la face. Dans cette perspective, le cinéma qui met en scène catastrophes et super héros chargés de les prévenir est un bon stéthoscope.
Certains historiens ont
tendance à penser que le cinéma d’Hollywood est intéressant dans sa façon de mettre en valeur les aspirations, les tensions et autres maladies d’une société occidentale hantée par la peur
d’assister à sa déchéance, de perdre la face. Dans cette perspective, le cinéma qui met en scène catastrophes et super héros chargés de les prévenir est un bon stéthoscope.
Qu’en est il de Superman ? A l’origine, un comic qui surgit à un moment où tensions diplomatiques et peurs dans un avenir incertain atteignent un paroxysme. Les années 1930 sont marquées du sceau de l’incertitude, et d’une certaine aggravation des violences légitimes, celles perpétrées au nom de l’Etat. L’adaptation de Superman à l’écran ne transgresse aucunement le contexte mis à jour par la bande dessinée. Après avoir été transposé notamment par Richard Donner à la fin des années 1970, Superman revient dans une cuvée 2006 faite avec les mêmes ingrédients ou presque. Si la plastique – numérique – a beaucoup changé depuis 1978, l’habit demeure tout comme l’idéologie véhiculée. Notre Superman est toujours cette figure démiurgique, capable de tout, et surtout de sauver cette piètre humanité condamnée au pêché et incapable d’y remédier. Si Superman est un prophète apportant la parole divine, il est aussi Dieu, père et fils, consubstantiel, figure capable d’assurer sa descendance dont la silencieuse création pourrait être appelée « Immaculée Conception ». Comme Bryan Singer l’annonce fièrement, Superman est un Américain. Un bon Américain inquiet de sa chère patrie esseulée et affolée devant tant de barbaries commises à son encontre. Les premières images entraperçues sur le poste TV de la mère de Superman le montrent : dans ces temps qui courent, il faut bien une idole afin de redorer le blason d’une nation dont l’image est entachée sur son sol comme à l’étranger.
Au-delà d’être un film messianique, Superman returns révèle à juste titre les préoccupations des hommes d’aujourd’hui. Depuis 1978, la mondialisation a atteint un certain degré de développement. Les hommes et les marchandises d’aujourd’hui circulent toujours plus vite et plus efficacement. Les préoccupations de l’intrépide et grotesque Lex Luthor le révèlent. Capable d’interférer dans une certaine mesure sur la plupart des processus naturels qui agissent quotidiennement, l’homme moderne n’est plus une victime du déterminisme naturel, des volontés de notre chère planète Terre. Demeure néanmoins une incapacité à maîtriser l’échelle des temps géologiques. Lex Luthor, à l’image de quelques apprentis sorciers scientifiques, se délecte à l’idée de pouvoir observer promptement la formation des roches, quitte à pouvoir agir et modifier le cours. L’obsession de Lex Luthor est-elle celle de l’homme de demain ? La volonté d’un homme moderne pressé de voir ce qu’il ne verra sans doute jamais ?
Même si Superman returns s’avère navrant, le film a bien une qualité. Pas celle d’un film à grand spectacle captivant ni véritablement passionnant, pas plus d’être drôle même si certaines scènes cocasses feront décrocher quelques sourires involontaires. C’est plutôt un document à ranger parmi d’autres, à l’instar de King Kong (1933), intéressants quant à la façon dont leur réalisateur respectif perçoit la société dans laquelle il vit, et la manière dont il véhicule et intègre ses codes.
Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola
 Oh my
god ! diraient les Anglo-saxons. En effet, inutile de passer par quatre chemins pour affirmer que Apocalypse now est un pur chef-d’œuvre. Le générique terminé, on a la
conviction d’avoir assisté à un très grand moment de cinéma. Peut-être l’œuvre ultime sur la guerre, les hommes, la folie. Devant ce film immense, il faut confesser son impuissance à l’analyser.
Réduire ce très grand film à quelques thèmes serait non seulement simplificateur, mais surtout, ce ne serait rendre justice à sa genèse tout comme à son créateur.
Oh my
god ! diraient les Anglo-saxons. En effet, inutile de passer par quatre chemins pour affirmer que Apocalypse now est un pur chef-d’œuvre. Le générique terminé, on a la
conviction d’avoir assisté à un très grand moment de cinéma. Peut-être l’œuvre ultime sur la guerre, les hommes, la folie. Devant ce film immense, il faut confesser son impuissance à l’analyser.
Réduire ce très grand film à quelques thèmes serait non seulement simplificateur, mais surtout, ce ne serait rendre justice à sa genèse tout comme à son créateur.
Ce qui semble univoque, c’est la façon dont Coppola endosse tour à tour la panoplie du documentariste, du psychanalyste, de l’ethnologue. En tant que grand reporter du conflit vietnamien, Coppola place sa caméra comme personne, filme des plans d’une force et d’une puissance émotionnelle sans commune mesure jusqu’alors. Curieusement, le grand spectacle « coppolaien » apparaît si brut et authentique qu’on le croit débarrassé de « mise en scène », et proche d’une certaine réalité militaire. Au reporter suit un historien ; à la capture de l’instant, suit la volonté de saisir toute l’ampleur du conflit, en comprendre ses tenants et ses aboutissants, par le biais notamment d’une discussion mouvementé à propos de la difficile décolonisation.
Comme pour Le Parrain, Apocalypse now est habité par une constante volonté de comprendre la nature humaine et les tréfonds de l’esprit, de l’âme. Le capitaine Willard n’est rien d’autre qu’un soldat meurtri et martyrisé : la folie est son double, le sacrifice, son destin. Quelles que soient ses motivations, la guerre du Viêt-Nam le possède, l’armée en fait son levier d’exécution. Résigné ou déchu, son chemin ne peut plus quitter cette terre ; son corps détaché, n’est plus que le jouet d’un esprit à jamais enfoui dans les profondeurs du pays. Dans cette mise en abîme, la mise en scène lorgne du côté du delirium, d’une atmosphère de fête foraine et de trains fantômes « massacre ». L’accompagnement musical, la théâtralisation de l’environnement confirment l’idée que le chemin parcouru est tout autant une descente aux enfers qu’un effroyable spectacle de la mort, de leur mort.
Mais Apocalypse now, c’est aussi une formidable aventure anthropologique. Après l’effroi, vient le temps de la stupéfaction, de l’émerveillement. Coppola part à la découverte de l’Autre, de peuples comme l’ont entrepris les plus grands noms de la discipline. Les pratiques initiatiques, les mécanismes de la fascination, du culte, du pouvoir et de ses représentations, tout comme la sensibilité vis-à-vis de la chair, en sont les thèmes les plus symptomatiques. Aux M-16 frénétiques succèdent des temples où la tragédie humaine se lit à travers des représentations héroïques et sacrificielles. Willard et Kurtz sont les mêmes personnages d’une même aventure dont le cheminement est aussi celui du spectateur : entrer est ne plus en sortir, ne plus jamais l’oublier.
Enfermés dehors (2006) de Albert Dupontel
 Enfermés dehors ou
comment Albert Dupontel revisite la fable sociale à grands coups de matraque et de parpaings. Du générique d'ouverture jusqu'au dernier plan, le film transpire la rage. La caméra survoltée suit
les pérégrinations d'un homme que la société a rejeté mais que les aléas temporels ont placé au devant de la scène. Le cinéaste donne à tous ces anonymes opprimés une dimension, une place à la
mesure de leur juste droit à l'existence. Le héros de Dupontel est un Chaplin francilien, la mélancolie en moins, la folie physique en plus. L'incommensurable énergie dégagée par ce candide des
squats bétonnés nous procure une bouffée d'optimisme à défaut de nous consterner par le cynisme de la réalité présentée. Si la naïveté vient tempérer cette rage, elle est complètement assumée et
bouleverse les rapports sociaux. Entre le merveilleux et le grotesque, le film nous transporte dans une histoire sordide mais enluminée par des personnages hauts en coeur et en couleurs.
Enfermés dehors ou
comment Albert Dupontel revisite la fable sociale à grands coups de matraque et de parpaings. Du générique d'ouverture jusqu'au dernier plan, le film transpire la rage. La caméra survoltée suit
les pérégrinations d'un homme que la société a rejeté mais que les aléas temporels ont placé au devant de la scène. Le cinéaste donne à tous ces anonymes opprimés une dimension, une place à la
mesure de leur juste droit à l'existence. Le héros de Dupontel est un Chaplin francilien, la mélancolie en moins, la folie physique en plus. L'incommensurable énergie dégagée par ce candide des
squats bétonnés nous procure une bouffée d'optimisme à défaut de nous consterner par le cynisme de la réalité présentée. Si la naïveté vient tempérer cette rage, elle est complètement assumée et
bouleverse les rapports sociaux. Entre le merveilleux et le grotesque, le film nous transporte dans une histoire sordide mais enluminée par des personnages hauts en coeur et en couleurs.
Comment rester insensible à la dimension civique du film, lorsqu'une misérable femme (interprétée par Yolande Moreau), SDF paumée à la grande débauche émotionnelle et généreuse, avoue se souvenir lointainement d'avoir entendu le mot démocratie ? Intercalée entre deux performances comiques, cette réplique est l'une des lignes de script les plus efficaces. Albert Dupontel a tord de ne pas assumer - par modestie - la dimension sociale de son film. Il n'est jamais inutile de dire ce que l'on croît être des poncifs. S'y refuser, c'est laisser libre cours à une propagande commerciale autrement plus efficace parce que sournoise, laisser le champ ouvert à des messages publicitaires où la liberté et le pouvoir de chacun se résumeraient à travers les mots COFIDIS et SOFINCO. Le film de Albert Dupontel réussit habilement à faire d'une farce potache, une comédie à caractère informatif aussi décapante que ce héraut des opprimés. Charge contre l'arbitraire et pour la défense des laissés-pour-compte, Enfermés dehors est surtout un film où l'on prend plaisir à voir un marginal devenir acteur de son époque.
Spy Game (2001) de Tony Scott

Sorte de Ennemi d'Etat en plus audacieux, plus penché sur la forme, Spy Game n'est jamais ridicule dans cette
tentative de décrire le milieu très fermé qu'est l'espionnage. Si le pari de Tony Scott était de vouloir faire une relecture de James Bond à la sauce américaine contemporaine, il dépasse
de loin ses espérances. L'écriture du film est très particulière, ce que la mise en scène contribue à rendre abstrait : une espèce de voyage dans le temps, où le point de départ, le présent,
se situerait dans le huis-clos d'un bureau de la CIA. Réflexion sur la capacité d'action que l'on nomme pouvoir, force de dissuasion politique, rouleau compresseur culturel (la machinerie
télévisuelle US), sur le rayonnement de la puissance américaine, le film brosse quelques traits de la géopolitique de ces 30 dernières années. En sus, l'interprétation est excellente. Brad Pitt
plus assagi qu'à l'accoutumée, et Robert Redford, impérial dans son costume d'agent espiègle, et calculateur.
L'écriture et les acteurs font corps avec une enveloppe visuelle particulièrement soignée. La mise en scène de Scott répond à cette démesure de la puissance. Elle donne de l'ampleur au propos, illustre par son montage saccadé, l'imbroglio des relations, des enjeux. Les plans rotatifs, les plongées, contre-plongées et travelling compensé en sont de formidables outils.
Spy Game est loin d'être le bête blockbuster écervelé que l'on présente si souvent. Que l'on adhère ou pas à la
gachette tony scottienne, le film dépasse les attentes du spectateur, en proposant une histoire d'espionnage audacieuse autant par sa structure scénaristique que par sa plastique enchanteresse.
Un autre film de Tony Scott qui mérite une réévaluation, notamment pour mesurer l'efficacité du script.
Tony Scott est-il un cinéaste mal aimé, injustement placé dans l'ombre de son frère Ridley - plus académique -; condamné par l'opprobre à chaque film réalisé ? On se le demande.
Bienvenue à Gattaca (1997) de Andrew Niccol
 Les films de science-fiction ne sont pas
monnaie courante. Certes, des films fantastiques à dose "de science" abondent, mais la part de ces mêmes qui esquissent une réflexion sur l'humanité, la place de l'homme dans un univers
"scientifique" est circonscrite à une poignée. Philippe K. Dick disait de la science-fiction qu'elle "était un méta-monde fermé sur une méta-humanité, une nouvelle dimension de nous-mêmes et
une extension de notre sphère de réalité tout entière; elle ne connaît de ce point de vue aucune limite". Si l'on se réfère à cette acception,
Les films de science-fiction ne sont pas
monnaie courante. Certes, des films fantastiques à dose "de science" abondent, mais la part de ces mêmes qui esquissent une réflexion sur l'humanité, la place de l'homme dans un univers
"scientifique" est circonscrite à une poignée. Philippe K. Dick disait de la science-fiction qu'elle "était un méta-monde fermé sur une méta-humanité, une nouvelle dimension de nous-mêmes et
une extension de notre sphère de réalité tout entière; elle ne connaît de ce point de vue aucune limite". Si l'on se réfère à cette acception, Bienvenue à Gattaca peut être
considéré comme un digne représentant.
Andrew Niccol a choisi de se pencher sur l'un des grands thèmes qui hante l'actualité de ces dernières années. A t-on réussi ou non à manipuler le génome humain, et à créer un homme de toute pièce ? A cette question qui demeure un grand mystère, y compris pour la communauté scientifique, le cinéaste est parti du constat de la faisabilité et en a imaginé l'étendue dans un monde édicté par la "loi du gène".
La société de Gattaca est placée sous le couperet de la Science. Elle croît aveuglément en son pouvoir. En ce sens, le film dénonce un courant néo-positiviste où la confiance en la théorie scientifique dépasse l'empirisme, celui là même qui a fait naître la science. La loi élaborée par l'expert occulte t-elle l'observation empirique de l'homme ? Le scientifique doit-il renier ce qui lui a servi de source ? Ici, à Gattaca, le code informatique, l'objet, parle davantage que le visage, la constatation "naturelle" de celui-ci. Dans une logique du triomphe de la Science sur l'imperfection de la Création, l'homme imparfait n'est plus à même de juger de la réalité, face à la connaissance suprême de la "machine" scientifique.
La traduction sociale de cette vérité est l'impulsion d'une nouvelle forme de discrimination fondée sur la pureté génétique. Une forme
d'eugénisme, dans lequel la science serait le juge opposant "générés" et "dégénérés". La suite coule de source chez le cinéaste : l'homme n'est plus soumis aux lois de la nature, mais à
celles qu'il a lui même élaboré. Guidé par cette pseudo-vérité pour une société toujours plus "parfaite", l'homme chercherait à réduire la part d'humanité qu'il possède afin de constituer un
nouveau produit scientifiquement "valide". Film sur l'emprise scientifique tout autant que film sur la nature humaine, Bienvenue à Gattaca est une oeuvre intéressante à plus d'un
titre, orientée vers un avenir dangereusement lisse à l'image de la photographie du film. Que ce soient nous ou nos futures générations, cette question existentielle ne nous échappera pas.
Le Nouveau Monde (2005) de Terrence Malick
 Certains films n'ont pas
besoin de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes, leur force étant souvent, au dessus des mots. Ces films là sont de la main des plus Grands, des metteurs en scène qui savent insuffler à
leur oeuvre une humanité qui dépasse de loin le simple écran de projection. Le
Certains films n'ont pas
besoin de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes, leur force étant souvent, au dessus des mots. Ces films là sont de la main des plus Grands, des metteurs en scène qui savent insuffler à
leur oeuvre une humanité qui dépasse de loin le simple écran de projection. Le Nouveau Monde est un de ces films là. Quitte à prendre le risque de simplifier le film à
quelques ellipses métaphoriques, ce cinéma mérite probablement qu'on lui dédie quelques lignes.
Que ce soit lors de l'ouverture qui annonce les bâteaux de sa Majesté approcher les rives de la Virginie ou de la fermeture sur le
ruissellement d'une source, le Nouveau Monde est un film sur l'eau. Ce n'est pas le Prélude de l'Or du Rhin de Wagner accompagnant majestueusement ces images qui me
contredira. Cette eau, c'est celle qui est la source d'une nature magnifiée, celle qui donne l'essence à toute vie sur notre planète. Cette nature bienveillante qui s'offre à nos yeux est
l'héroïne principale, ou plutôt le dénominateur commun à toutes les destinées. Ces hommes qui s'aiment, se boudent, se déchirent sont des êtres vivants inscrits dans celle-ci, faisant partie de
ce tableau. Inutile de chercher la prédominance de l'un sur l'autre, Terrence Malick ne les détache jamais mais les explique dans une démarche holistique. C'est un tout où l'ensemble l'emporte
sur le singulier. De cette nature, l'homme y tire une énergie, une âme dira Pocahontas, quelque chose qui donne à l'homme sa foi, son amour. Tout est beau chez Malick, la nature comme les hommes.
Même les évènements facheux sont balayés par la puissance de cette volupté bucolique, l'ennivrement tropical qui emporte chacun dans un tourbillon d'émotion et de douceur. Onirique, le
Nouveau Monde est moins une représentation historique de la rencontre entre deux civilisations plutôt que la vision d'un artiste émerveillé, d'un Gauguin subjugué par toutes ces
figures féminines. A la manière du capitaine John Smith qui carresse les cheveux de Pocahontas comme il effleure les herbes d'un geste de main, on abordera le Nouveau Monde, comme on
le ferait d'une pépite qui nous est précieuse : avec sensibilité et délicatesse.

Depuis les deux premiers volets des Bronzés, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le concept à la base était louable. Une
troupe de comédiens-copains jouaient la carte d'un grotesque pleinement assumé dans lequel chacun contribuait à une certaine joie de vivre assez communicative. Comédie potache, les
Bronzés n'ont jamais revendiqué d'être autre chose. Or, dans les Bronzés 3, il n'est même plus question de cela.
En l'espace de 27 ans, les copains-malins sont devenus des "stars" de l'espace cinématographique français. Les moeurs se sont embourgeoisées
et la franchise en a prit un coup. Il y a de la volonté certes, mais les habitus rattrapent vite le désir des comédiens. Nos Bronzés se sont crispés et s'efforcent désespérément
d'être ce qu'ils ont été jadis. Au-delà de l'interprétation franchement poussive, le scénario est d'une platitude déconcertante. En plus d'être mal écrite et sans inspiration, la mécanique est, à
l'image de ces Bronzés rouillés, très mal huilée. Fait de bric et de broc, rafistolé sur un comptoir, le "scénario" se prolonge laborieusement afin de remplir de la pellicule et
faire de cet "éternel court", un long métrage. Inutile d'insister sur l'accompagnement musical, qui, en plus d'être peu original, n'est plus synchrone avec le ton décalé des opus initiaux.
On rie moins à tue-tête que l'on en apprend sur l'évolution de notre société contemporaine : judiciarisation outrancière, rapports
sociaux conflictuels, exigences maniaques du risque zéro. Pas de doute, les Bronzés comme la société, sont devenus l'archétype de l'individualisme primaire, de l'égocentrisme
occidental qui rongent notre joie de vivre et notre humour communicatif.
M. Butterfly (1993) de David Cronenberg
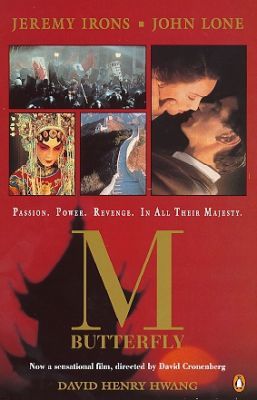 René Gallimard, consulaire
français en exercice à Pékin, est l'archétype de l'Occidental venu rencontrer l'Orient. Un schéma préconçu, une vision de la femme orientale qui tend à l'idéaliser, du moins à la mettre en
valeur. Mais comme le rappelle sa compagne, "il n'y a pas de rencontre entre les deux mondes", autrement dit pas d'assimilation. La culture asiatique interprétée par René n'est pas faite de
métissage, mais d'une simple version de l'amour romantique, "exotique" qui échappe aux Occidentaux. Ebloui par cette culture, René peut dès lors basculer dans une réalité imaginée.
René Gallimard, consulaire
français en exercice à Pékin, est l'archétype de l'Occidental venu rencontrer l'Orient. Un schéma préconçu, une vision de la femme orientale qui tend à l'idéaliser, du moins à la mettre en
valeur. Mais comme le rappelle sa compagne, "il n'y a pas de rencontre entre les deux mondes", autrement dit pas d'assimilation. La culture asiatique interprétée par René n'est pas faite de
métissage, mais d'une simple version de l'amour romantique, "exotique" qui échappe aux Occidentaux. Ebloui par cette culture, René peut dès lors basculer dans une réalité imaginée.
Ce film se pose - volontairement ou non - dans la continuité de Faux Semblants. Après avoir interrogé la réalité des liens qui
unissent des jumeaux monozygotes, David Cronenberg continue sa réflexion sur l'identité en se penchant sur ce qui différencie l'homme de la femme. La femme est-elle un homme qui se veut
femme ? L'homme, au centre de la société asiatique, est-il plus à même de la comprendre, et de l'incarner ? Au delà, le film renvoie à l'image que l'on se fait de l'amour. Cette
représentation projetée, plaquée sur le visage de l'aimé(e) importe t-elle plus que la personne derrière ce masque ?
Comme à l'accoutumée, l'approche de Cronenberg est fascinante. La mise en scène, délicate et toute en retenue, fait de cette histoire de papillons humains, un drame romantique profondément émouvant. Jeremy Irons, glacial, campe avec brio ce rôle d'homme désespérément "bloqué" dans une réalité qu'il rejette au profit d'une invention. Howard Shore à la musique et Peter Suchitzky à la photographie sont toujours en osmose avec le point de vue du cinéaste; Tout est juste, précis, sans fioritures.
Un excellent film malheureusement méconnu, une formidable occasion de mesurer toute l'étendue de la démarche de Cronenberg.
Le secret de Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee

Aux laissés pour compte d'hier et d'aujourd'hui, bienvenue à Brokeback Mountain. Le film de Ang Lee (Tigre et
Dragon - 2000) propose une des plus belles histoires d'amour entre deux êtres, rendue impossible par un certain nombre de paramètres extérieurs, produits exogènes d'une société figée dans
ses principes dogmatiques.
Au delà de cette très belle romance dans les confins de l'Ouest américain, Brokeback Mountain est un tableau de la dualité
caractéristique de l'homme, non opposée à la manière de la tradition manichéenne chrétienne, mais complémentaire à la manière du ying et du yang de la pensée chinoise. De cette culture qui
imprègne les rapports sociaux et la façon dont les individus conçoivent le monde, se dégage une logique de stigmatisation, de marginalisation de ceux qui ne seraient pas conformes aux principes
du dogme. Quelle plus belle illustration que ce film pour les idées du sociologue Ulrich Becker : "On ne naît pas déviant, on le devient parce que l'on est désigné comme tel". Les règles de
conduite, de morale sont-ils les freins au bonheur des hommes ? Les structures qui régissent la société restreignent-elles nos espaces de liberté ?
Ang Lee propose plutôt qu'il n'impose. En filmant avec beaucoup de franchise, de délicatesse, il brosse une histoire d'amour touchante, profondément humaine. Il filme avec retenue, sans jamais tomber dans la facilité, le cliché. Les deux amants sont superbes. On sourit souvent de complicité, on partage leurs joies, leurs instants de bonheur en même temps qu'on souffre de leurs difficultés à affronter les torrents de la bienséance sociétale.
En ce début du XXIe siècle, on aurait pu être amusé d'étonnement en regardant cette "réalité" de l'homosexualité de 1963. Hélas, malgré quelques changements de moeurs qui ont évolué ici et là, tâche est de constater qu'il est toujours aussi difficile d'être un humain aimant un autre en dehors du "cheptel" social auto-désigné par une société crispée.
The Constant Gardener (2005) de Fernando Meirelles
 Après un brûlot à tendance sociale qui a
frappé les spectateurs en 2002 (
Après un brûlot à tendance sociale qui a
frappé les spectateurs en 2002 (La Cité de Dieu), Fernando Meirelles renouvelle son engagement en adaptant la fiction éponyme de John Le Carré. Film engagé, The Constant
gardener est un morceau qui laisse un goût très désagréable dans la bouche, à l'image peut-être de cette fausse pillule Dypravax supposée guérir les populations kenyannes. Inutile
d'insister sur la monstrueuse hypocrisie que présente le commerce et la diffusion des médicaments (la vision de ce film se suffit à elle-même), révulsante si elle en est. La mise en scène - très
personnelle - tout comme le traitement du matériau d'origine sont particulièrement convaincants. Ralph Fiennes et Rachel Weisz sont au diapason; la photographie soignée est bien appropriée aux
différentes tonalités moite et brûlante du film.
Il y a chez ce metteur en scène brésilien une certaine récurrence du thème sacrificiel et ses références christiques. La crucifixion de Bluhm, la mort de Justin ou celle de Tessa sont autant de passages où les protagonistes s'offrent - religieusement - à la cause qu'ils défendent. La présence de la Holy Bible insiste probablement sur le fait que, au-delà de l'échec que peut représenter leur action sur le terrain, leur sacrifice est une façon de "triompher" de la mort. C'est aussi une manière de laisser l'image - et la marque - d'un engagement charnel avec la souffrance de ces populations africaines.
Good night and good luck (2005) de George Clooney
 Un vent
de contestation souffle sur Hollywood ces temps ci. Après
Un vent
de contestation souffle sur Hollywood ces temps ci. Après Lord of WarJarhead et les désillusions d'une guerre vendue comme un "shoot'em up" grandeur nature, Good
night, and good luck rejoint le cercle des films engagés où il est question d'une certaine remise en question des idées reçues; d'une critique plus ou moins féroce de
"l'establishment". et sa dénonciation du trafic d'armes,
La première idée que le film de George Clooney soulève est la question du rôle du journalisme. Edward R. Murrow, reporter à CBS News dans les années 1950, dénonce la "chasse aux sorcières" qu'alimentent les diatribes récurrentes du sénateur Joseph McCarthy à propos du communisme. Pour contrer cette gigantesque psychose, le journaliste rétorque par des éléments qui ont tout de la contre-propagande politique. Pour faire de son action une profession de foi, le journaliste joue de la fascination qu'a le public pour l'image et la petite boîte télévisuelle. Il aborde tout un pays, happe littéralement ces foyers majoritairement endoctrinés par la peur véhiculée par le sénateur du Wisconsin. La vérité peut-elle découler d'une certaine forme de prosélytisme civique, ou du moins, informationnel ? La fin - aussi bienfaitrice soit-elle - justifie t-elle les moyens ? Oui et non.
Le film se pose ainsi comme un défenseur du rôle de la presse comme pilier d'un régime démocratique dans lequel la liberté d'expression est une garantie de sa pérennité. Edward R. Murrow parle de la République comme jadis le faisait Camille Desmoulins à propos d'une mission que d'aucuns semblent oublier : "Ayez la liberté de la presse à Moscou, et demain Moscou sera une République". Néanmoins Clooney tempère cette vision et nuance son propos. Par le biais de ce qui est à nos yeux le dernier discours de Murrow, le cinéaste insiste sur le danger que réprésente l'instrumentalisation de cette boîte à images hypnotisante. (Cf. Publicités sur les cigarettes Kent).
Good night, and good luck est joli dans sa robe noire et blanche comme il est juste dans son interprétation artistique. Jamais
caricatural ni trop "anguleux", le second film de George Clooney se pose à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Les nombreux documents d'archives qui ponctuent le film sont autant de
sources pour l'historien que d'interrogations pour les citoyens que nous sommes aujourd'hui.
Détail amusant : Le Edward R. Murrow de Clooney ressemble étrangement au Bertrand Delanoë de Paris : curieuse coïcidence, non ?
Lord of war (2005) de Andrew Niccol
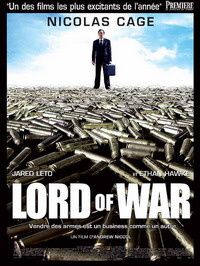 Lord of War
Lord of War
Mais si la mise en scène est éléphantesque, peut-être est-ce aussi du à son sujet. Cette réalité pourtant si énorme, semble nous échapper, à la manière de l'éléphant de Gus Van Sant dont on perçoit difficilement le danger au quotidien. Le propos du film est délicat, un peu à la manière de cette grosse patte d'éléphant. Dénoncer le gigantesque trafic d'armes qui alimente les multiples conflits africains n'est probablement pas un truisme. Est-ce un devoir civique pour nous citoyens du monde, préoccupés à se pencher vers les autres, prêts à partager notre sollicitude et user de notre philanthropie ? A l'image de ce qu'a dénoncé Ahmadou Kourouma dans son très beau livre Allah n'est pas obligé, le film pointe tout particulièrement l'instrumentalisation dont sont victimes les jeunes Africains, poussés d'un camp à l'autre, l'arme à la main, devenant un court instant, ces "enfants-soldats".
Est-il utile d'insister - à la manière de Hubert Sauper - sur le rôle des grandes sociétés multinationales et des pays occidentaux dans
cette tuerie à grande échelle ? Sans doute. Il faudrait rappeler que le processus de mondialisation, initialement chargé d'espoirs de partage des richesses, est devenu au fil des décennies
une gigantesque hypocrisie en même temps qu'un formidable (sic) instrument de promotion de la misère et de la mort. Si l'utilisation des artifices visuels est nécessaire afin de percuter les
esprits - quitte à se détourner un court instant de la sobriété du documentaire-, alors Lord of War peut être vu comme une réussite. Il s'inscrit dans le sillon restreint des "gros"
films réfléchis et intentionnellement remuants.
Trois enterrements (2005) de Tommy Lee Jones
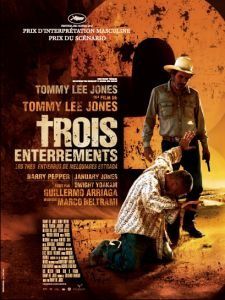 C'est l'histoire
d'une certaine confrontation entre deux mondes, deux populations. D'un côté, la vision d'un garde-frontière US qui campe une position idéologique, défend son limes nord-américain face à
l'intrusion des "étrangers". De l'autre, des migrants mexicains qui transgressent cette "ligne" - en pointillés - pour tenter leur chance dans cette autre partie de l'Amérique.
C'est l'histoire
d'une certaine confrontation entre deux mondes, deux populations. D'un côté, la vision d'un garde-frontière US qui campe une position idéologique, défend son limes nord-américain face à
l'intrusion des "étrangers". De l'autre, des migrants mexicains qui transgressent cette "ligne" - en pointillés - pour tenter leur chance dans cette autre partie de l'Amérique.
Y a t-il vraiment une frontière ? Quel sens recouvre t-elle dans un espace où les hommes, les cultures s'interpénètrent, et alors qu'auparavant, ce même espace était organisé par les Mexicains ? Entre ces deux façons de voir le monde, se trouvent un médiateur, un passeur : Tommy Lee Jones. Il représente un trait d'union, celui qui va accompagner cet américain vers l'ouverture aux autres, vers la rédemption. Au fil de ce chemin initiateur, on prend conscience de l'ambiguité de la notion de frontière. D'un mur obstacle qui coupe deux mondes, elle devient humaine, dans laquelle le territoire n'est plus seulement "étatsunien", mais américain, lieu d'échanges, de dialogues et de partage à la manière de ce "lunch" offert au détour d'une vallée.
D'un blocage culturel, d'une crispation sur ces privilèges occidentaux à l'appréhension des autres, Trois enterrements est un
film qui initie le spectateur à regarder différemment ceux qu'on appelle "étrangers", à comprendre leurs motivations, leurs griefs. La qualité de l'écriture (Prix du scénario au Festival de
Cannes), de la mise en scène et de l'interprétation donne au film de Tommy Lee Jones une dimension originale à un thème - les échanges - pleinement inscrit dans le monde d'aujourd'hui.
King Kong (2005) de Peter Jackson
 Les gorilles sont à
la mode ces derniers temps. D'un côté, la une des magazines géographiques - Géo, en l'occurence - dressent le constat accablant de la disparition progressive de ces espèces via leur
exploitation prédatrice. De l'autre, Peter Jackson en fait la "star" de son dernier film.
Les gorilles sont à
la mode ces derniers temps. D'un côté, la une des magazines géographiques - Géo, en l'occurence - dressent le constat accablant de la disparition progressive de ces espèces via leur
exploitation prédatrice. De l'autre, Peter Jackson en fait la "star" de son dernier film.
Contrairement aux braconniers, Peter Jackson est amoureux de ce gros singe. Pas forcément de la bête en elle-même - enfin qui sait ? -
mais de tout ce qu'elle représente à ses yeux dans l'histoire du cinéma. Dans cette démarche de passionné, son oeuvre se positionne de façon respectueuse voire dévotionnelle face à son
prédécesseur (King Kong - 1933). Jamais le rejeton de 2005 ne trahit son géniteur ; pas de transgressions, mais plutôt une recherche transcendante dans laquelle l'auteur tente
de sublimer la créature et sa bien aimée par un recours judicieux aux artifices du lyrisme.
Fidèle mais pas moins singulier. Peter Jackson approfondit certaines démarches du film de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack en jouant avec les échelles. En alternant les focales courte et longue de manière quasi systématique, il confronte les points de vue, confère au Kong une nouvelle dimension par rapport à son environnement et les différents personnages qui le peuplent. Par ce procédé, l'idole est démultipliée, la sensation de vertige renforcée.
Le budget colossal du film n'a pas été gaspillé. Jackson avait démontré auparavant dans sa trilogie tolkienne que l'utilisation de la grosse
machinerie technicienne et technologique devait servir son film, non le remplacer. Des scènes numériques aux costumes, King Kong s'apparente à une oeuvre pleine et référencée. Dès le
générique, le film multiplie les clins-d'oeil au 7ème Art (Du Hollywood des années 30 à ces propres films : indice "Sumatran Rat Monkey"). La reconstruction minutieuse de New York, du
contexte dépressif et de l'environnement artistique plaira tout autant aux amateurs d'histoire qu'aux cinéphiles avertis.
Que peut-on vraiment reprocher ? Certes on pourrait tiquer sur certains effets faciles - et inutiles - dont le metteur en scène use et
abuse (ralentis), sur la représentation des indigènes ( trop typée Seigneur des anneaux ?), mais que sont-ils face à ce maniement de la caméra hors pair et ces magnifiques travellings de Skull
Island et New York ? Peter Jackson a réussi son pari. Ce King Kong est une variante réussie de son modèle. Tour à tour brutal, émouvant, cruel, doux, haletant, ambigu, ce film
transpire une certaine passion pour le 7ème Art. Il ravira tous ceux pour qui le cinéma est synonyme de plaisir et d'émotion, aux amateurs d'un spectacle intelligent et digeste. King
Kong se pose sans doute comme le meilleur blockbuster de cette année.
Lost Highway (2005) de Maître David Lynch
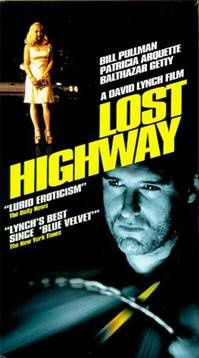 Le générique s'ouvre, le coeur
bat et le souffle est retenu. Alors que David Bowie accompagne musicalement cette route bitumée qui défile sous nos yeux, le spectateur se rend progressivement à l'évidence : il vient
d'assister à un grand moment de cinéma.
Le générique s'ouvre, le coeur
bat et le souffle est retenu. Alors que David Bowie accompagne musicalement cette route bitumée qui défile sous nos yeux, le spectateur se rend progressivement à l'évidence : il vient
d'assister à un grand moment de cinéma. Lost Highway est de ce genre de films dont on ne quitte jamais, convaincu d'avoir assisté à une sorte de "big bang" particulièrement
déstabilisant, éprouvant pour toute personne normalement constituée.
Tenter de faire une analyse de ce qui s'est déroulé dans notre tête est loin d'être une sinécure. L’exercice devient rapidement un calvaire dès lors que l'on essaye de dégager du "chaos" une cohérence, une logique. Que s'est-il passé ?
Lost Highway est une sorte de voyage temporel à la recherche d'une identité, d'une sensation que l'on souffre avec le caractère
principal. La traversée de ces espaces physiques, cérébraux s'affranchit totalement des lois telles qu'on les connaît. C'est un chemin hasardeux, tortueux où chaque détour est scruté de l'oeil du
cinéaste, amusé de nous suprendre, de nous perdre. En entrant avec Fred Madison dans ce passage obscur de sa maison, on découvre une représentation de son esprit, de ses peurs, de ses
frustrations.
Mais c'est peut-être aussi une métaphore d'un pandémonium supposé ou réel. Démonette toute de noire vêtue, Renée est le suppôt de la Tentation, l'archange du vice, du plaisir. Elle est le coupable des troubles psychiques de Fred et Pete. C'est aussi un univers dominé par la photographie brûlante (lumière ensoleillée, chaleur, moiteur de la chambre), une vision de l'enfer carcéral, d'une condamnation issue d'un jugement factice. Le monde représenté tant à devenir cette réalité que le "héros" tend à fuir; ce présent basé sur le passé auquel il n'est plus maître, et ce futur dont il n'assume pas les responsabilités. Encore une fois, le temps est brisé, la trame logique rompue.
A moins que ce ne soit une histoire d'amour sensuelle, faite de romance insolente et surréaliste ? Touchée par la grâce de Patricia Arquette, frappée par la puissance des mots, la force de cet "idylle" réside peut-être dans le pouvoir de convoitise que génère ce modèle féminin. Renée est véritablement l'objet de rupture, du couple, du temps, de l'espace. Elle cultive les passions, la jalousie, la violence. Dès lors, l'histoire devient cynique, et les hommes, ses serviteurs.
Mais c'est quoi, au final, Lost Highway ? C'est un peu de cela et tant d'autres choses. Un film tellement riche,
fascinant, attirant, repoussant, qu'il est impossible d'en saisir les contours. Il est totalement vain de vouloir l'enfermer dans un carcan thématique que l'on appelle registre. On sent David
Lynch envahi par un nombre incommensurable d'idées, écrasé, enfermé dans son support qui n'est pas à même de restituer sa démesure créatrice. Ce cinémascope est définitivement trop étroit pour
lui, tout comme cette histoire trop courte. Pour donner davantage d'indices au spectateur quant à son génie créateur, Lynch use de l'accompagnement musical et de la photographie; utilise les
ruptures de tons, de couleur, de plans.
Il est inutile de vouloir insister plus longtemps sur l'analyse du film. Lost Highway ne se décrypte pas, mais se vit. C'est un
film multi-sensoriel que l'on reçoit comme une goutte d'eau sur le visage; que l'on ressent comme le souffle violent d'une tempête ou que l'on goûte à l'instar du délicieux parfum de
Patricia.
Une chose est sûre : de l'apparent chaos qui semble régner dans l'esprit du géniteur ressort un incroyable aboutissement mise-en-scénique. Le cinéphile a t-il touché le Saint-Graal cinématographique ? Probablement. Du moins, il a vécu un film qui peut être l'incarnation à lui seul de l'essence artistique du cinéma.
De battre mon coeur s'est arrêté (2005)
 De battre, mon coeur s'est arrêté
De battre, mon coeur s'est arrêté
Jacques Audiard nous offre la démonstration de ce qui fait peut-être de nous un humain, et plus particulièrement de celui que nous sommes en ce début du XXIe siècle, dans un monde dominé et dynamisé par la société urbaine.
L'humain de Jacques Audiard - Thomas - se définit par un environnement dans lequel il évolue. Ici il est question d'un milieu immobilier et où notre personnage incarne un agent. Cette activité amène naturellement les individus à entrer en contact les uns les autres, pourtant, ce mécanisme ne semble pas fonctionner.
C'est que l'humain se caractérise aussi par un horizon social, or, celui de Thomas est particulièrement restreint. Au-delà de ses contacts commerciaux qui ne sont que des mensonges, l'étendue de son champ visuel et social se limite à son père et à la musique de son baladeur qui le rend plus encore encerclé. Ce n'est pas la voiture et son habitacle qui permettent à notre "héros" de s'échapper, ni le cadre de la caméra qui semble l'emprisonner, reserré pour mieux l'étouffer. Non, Thomas est bel et bien victime du paradoxe du nouveau citadin.
On peut définir aussi l'humain par sa capacité à communiquer et les rapports qu'il entretient avec le reste de ses congénères. Ici, les blocages se manifestent à plusieurs reprises, si bien que la fluidité sensée caractériser la normalité des rapports humains devient crispation, lorsqu'elle ne suscite pas la violence et le rejet misanthrope. "On s'est tout dit" fustige son père. Est-ce le résultat d'une impossibilité physique de communiquer avec l'autre ou l'incapacité, le refus de communiquer ?
Dès lors, notre homme Thomas cherche une rédemption, bien conscient que son chemin est entravé par quelques obstacles, ou du moins, n'est pas celui qu'il voudrait continuer. Une nouvelle voie s'ouvre à lui par le biais de la musique, jouée cette fois-ci, non simplement écoutée passivement. Le piano apparaît ici comme la combinaison des différents éléments énoncés précédemment. Il est un outil qui peut permettre à Thomas de s'ouvrir, mais en même temps, l'exercice qu'il nécessite le contraint à un certain repli. Pour se libérer des derniers fers qui le tiennent, Thomas choisit alors la fuite en avant, avec tout ce que cela implique pour un personnage fragile et désabusé.
Romain Duris campe avec brio cet humain, trépidant et désorienté. Il est totalement impliqué dans ce rôle insaissiblable. Jacques Audiard, est quant à lui, le chef-d'orchestre doué de ce film inclassable, à la mise en scène tantôt retenue et légère, tantôt brute et lourde. Oeuvre psychologique et conte âpre aux allures vengeresses, le film de Jacques Audiard n'est jamais l'un ou l'autre. C'est peut-être sa force comme sa faiblesse, mais aussi ce qui fait sa singularité.
Le cauchemar de Darwin (2005) de Rupert Sauper
 Les mots peuvent-ils ici exprimer davantage que ce que nous montrent les
images ? Il faut rendre à Hubert Sauper le mérite d'avoir réalisé un tel documentaire et nous prouver - images à l'appui et si besoin en est - que la misère humaine n'est pas une fatalité
dictée par la providence divine, mais au contraire, le ressort des hommes, et en particulier celui des Occidentaux. La liberté n'est qu'un vain fantôme lorsqu'une classe d'homme peut affamer
une autre impunément. Cette citation de Jacques Roux trouve ici un écho insoupçonné. Deux cent douze ans après avoir été prononcée, sa valeur demeure intacte, sa portée, totale.
Les mots peuvent-ils ici exprimer davantage que ce que nous montrent les
images ? Il faut rendre à Hubert Sauper le mérite d'avoir réalisé un tel documentaire et nous prouver - images à l'appui et si besoin en est - que la misère humaine n'est pas une fatalité
dictée par la providence divine, mais au contraire, le ressort des hommes, et en particulier celui des Occidentaux. La liberté n'est qu'un vain fantôme lorsqu'une classe d'homme peut affamer
une autre impunément. Cette citation de Jacques Roux trouve ici un écho insoupçonné. Deux cent douze ans après avoir été prononcée, sa valeur demeure intacte, sa portée, totale.
Loin des recherches occidentales actuelles qui se penchent sur la notion de développement endogène, où les populations locales participeraient selon leurs capacités et leurs choix économiques, culturels au processus d'ensemble ; ici, il n'est même pas question de progrès.... mais plutôt d'un monstrueux paradoxe. Berceau de l'humanité, la région des Grands lacs africains est connue pour être riche de ressources naturelles. Loin de l'image de l'Afrique semi-aride ou aride, cette zone dominée par un climat tropical humide - à saisons alternées - ne devrait pas être l'expression de la famine...et pourtant. Le poisson, en l'occurence la perche du Nil introduite a posteriori dans le lac Victoria fait l'objet d'un commerce occidentalo-occidental d'envergure dont les autochtones en sont exclus. L'exploitation unilatérale de ce grand commerce qui conduit des centaines d'avions à se poser sur le sol de la Tanzanie génère un profit qui ne concerne pas les populations, pas mêmes les retombées socio-économiques que cela pourrait engendrer. Les diverses structures installées sont issues de capitaux étrangers, et se limitent pour la plupart à des infrastructures agro-industrielles dirigées et contrôlées par des Blancs. Les poissons préparés sont expédiés vers l'Europe, laissant aux populations les détritus restants.
Il y a pire que de ne pas faire profiter autrui de son profit : celui d'apporter la mort. C'est l'un des effets pervers de ce système, où via les avions cargos, circulent des armes clandestines qui alimentent les guerres civiles du bassin congolais. Commerce prédateur ? Très certainement.
Dès lors, la démonstration du cinéaste est entendue : le système actuel qui repose sur la mondialisation des échanges, des capitaux et des hommes ne profite qu'à une couche restreinte de privilégiés qui spolient la grande majorité des plus démunis. Les quelques discours et autres conférences élitaires filmés ici sont la preuve d'une incroyable hypocrisie quant à la réalité concrète vécue par les habitants du pourtour du lac Victoria.
En plus d'être finement mis en scène, le documentaire d'Hubert Sauper est une oeuvre incroyablement limpide et pédagogique. Il insiste sur cette idée fausse, prétexte utilisé par l'idéologie consumériste qui voudrait que cette situation cauchemardesque soit la résultante de la "nature". Il n'y a pas de déterminisme naturel, mais une responsabilité humaine collective, en l'occurence celle d'un commerce international unilatéral qui exploite la vulnérabilité des plus exposés. Dans cette perspective, ce film est d'intérêt public. Vivement recommandé.
Tueurs nés (Director's cut) (1994) de Oliver Stone
 Difficile de ne pas penser lors de la vision de ce film à
Difficile de ne pas penser lors de la vision de ce film à Sailor
et Lula. Au road movie onirique et vicieux de David Lynch, Oliver Stone nous sert ici un néowestern sauvage et totalement irrévérencieux. Sans entrer dans la vive polémique répandue dans
nos contrées gauloises ainsi qu'outre-atlantique, le film se place continuellement sur le fil du rasoir. Entre la comédie trash sur fond de sitcom décalée - qui fait sourire - et la critique de
l'influence télévisuelle occidentale, on trouve un patchwork assez virulent qui oscille entre mauvais goût et déstabilisation choquante lorsqu'elle n'est pas décourageante. Si Stone ne fait pas
ouvertement l'apologie de la violence - enfin, du moins on l'espère - sa mise en scène et son utilisation frôle parfois les limites d'une certaine "moralité". Le scénario - passable - se laisse
suivre sans déplaisir, il est surtout mis en valeur par un montage ébouriffant, et sa capacité à compiler une multitude de formats différents (super 8, 16, 35mm). "Really impressive". La
photographie et la musique sont dans le ton exhubérant du film, elles accompagnent des acteurs cabotinant en permanence. Outre les deux héros principaux du film, on notera au passage la
performance de Robert Downey Jr. et Tommy Lee Jones, véritables piles électriques amphétaminées. Un film curieux, excessif, et problématique. Difficile en effet de porter une opinion tranchée sur
cet OFNI. Est-ce un brûlot anti-médiatique ou simplement un pur produit en réaction à un certain ras-le-bol du conformisme cinématographique de son temps ?
Domino (2005) de Tony Scott
 Tony Scott est très énervé. Il nous l'avait déjà démontré dans son
Tony Scott est très énervé. Il nous l'avait déjà démontré dans son Man on
Fire précédent, mais ici, tout est démultiplié jusqu'à l'usure. La mécanique de son cinéma repose pour beaucoup sur l'utilisation d'un très grand nombre de plans (des dizaines à la minute)
associés dans un montage "tendu", qui confère au tout, un rythme effréné. Mais rassurez-vous : derrière la frénésie de la caméra (Tony Scott filme comme un fou soudainement libéré de sa
camisole) se cache un maître doué. Le résultat est un effet "big bang" dans la tête du spectateur. La mise en scène ouvre une "nouvelle" dimension où les trois autres se confondent, pour en faire
jaillir une autre, quelque part entre l'obturateur du projecteur de cinéma et ce qui se passe à l'écran.
Dans cette histoire qui se frotte à divers genres, se distinguent un scénario alambiqué (Richard Kelly) et des acteurs talentueux. Outre les Mickey Rourke et Christopher Walken (plus effacé),
véritables "gueules" de service, il y a la ravissante Keira Knightley, même si le mot "dévastatrice" serait plus approprié que celui connotant un conte de fée. Ce n'est pas à une princesse que
nous avons affaire ici, mais à un redoutable modèle transformé en "killeuse" sexy. Tony Scott n'a probablement jamais aussi bien filmé une telle rebelle sensuelle, même si on lui reconnaît
certains dons en la matière (Patricia Arquette dans True Romance).
Le plus américain des metteurs en scène britanniques ne passe pas quatre chemins pour aller droit où ça fait mal. Il se moque de la convenance et du bien-pensant hollywoodien, de sorte que le tout est particulièrement démonstratif et irrévérencieux, corrosif et clinquant. Son film sent la sueur et la poussière, servies notamment par la très belle photographie de Daniel Mindel (le rendu ocre est vraiment magnifique). Cependant tout n'est pas parfait. A force de succession de plans en tous genres, la mise en scène a tendance à manquer d'un point de vue, ce que la distanciation artistique (rendue possible par la multiplication des sujets, de leurs formes, de leurs apparitions) contribue à renforcer. La mécanique sur laquelle repose le film tourne quelque peu à vide vers le dernier tiers. Sans doute manque t-il un certain "fil conducteur" pour donner au tout davantage de cohérence, et éponger le caractère trop "éclaté" du film.
Cela dit, le film n'en reste pas moins l'un des actioneers (N'est-il que cela ?) les plus intéressants qu'il nous a été donné de voir depuis des lustres. Si le final de True
Romance était séduisant, ici, sa puissance visuelle laisse bouche-bée (tout est multiplié par 100). Même si Tony Scott se range plutôt du côté des chevillards que des orfèvres, son cinéma
n'est pas pour autant démérité, et reste pour le moins stupéfiant d'intensité. Voir Domino sur un grand écran est une expérience cinématographique singulière, recommandable à
n'importe quel amateur du Septième art et des nouvelles expérimentations visuelles. Aux antipodes du dernier film de Cronenberg (tout les oppose ou presque) et à un public visé foncièrement
différent, Domino est pêut-être la démonstration la plus efficace quant au fait que le cinéma se distingue avant tout par sa mise en scène. Mais c'est aussi un morceau de son temps.
Energique, multicolore, métissé, il est un témoin de la diversité et de la richesse des cultures contemporaines. Les choix d'accompagnement vidéo et musicaux en sont les meilleurs exemples à ce
sujet. Abrupt mais sincère, tape-à-l'oeil mais passionné, ce film est une franche réussite, n'en déplaise aux mauvaises langues habituelles.
A history of violence (2005) de David Cronenberg
Peu importe si
A history of violence n'est pas le
meilleur film de David Cronenberg. Il est suffisamment sournois, vicieux pour être totalement cohérent avec le reste de son oeuvre, et assez audacieux et abouti pour être un grand film tout
court. Le canadien est un malin. Non seulement il a le courage de traiter un sujet rassassé, mais en plus il a le culot de se jouer des conventions du genre, dans une formule que l'on pourrait
résumer par "digérer, s'approprier les stéréotypes pour mieux les contourner et surprendre son public". Si les thèmes délicats du rapport à la violence, sa nature et ses manifestations ont déjà
été esquissés par un certain nombre de cinéastes (on pense à Sam Peckinpah dans Les chiens de paille), Cronenberg nous propose ici une autre façon d'appréhender le phénomène, dont le
contenu artistique et sociologique doit susciter notre curiosité.
Le message principal tend à nous montrer que la violence, imagée, représentée par chacun d'entre-nous n'est pas celle que l'on croît. Pulsion destructrice, elle est un exutoire des frustrations inhérentes au genre humain, une manifestation de la complexité de notre personnalité. Au delà de la question sur la nature de cette violence, le cinéaste nous fait réfléchir sur les rapports hypocrites qu'entretiennent la société contemporaine - US ? - avec elle. Dans une fédération où certains Etats sont célèbres pour l'inscription de la peine capitale dans leur code pénal, la violence peut être légitimée, justifiée, du moins pesée. Une autre violence, pas radicalement différente quant à sa nature et son objet, mais à la manifestation singulière, est elle, rejetée. Comment faut-il interpréter toute cette ambiguité dans notre rapport à la violence ? A vous de construire votre point de vue. Le cinéaste lui, se place judicieusement sur le fil du rasoir, et n'a pas choisi de trancher. (le très beau final est là pour le rappeler).
Comme à l'accoutumée chez David Cronenberg, la mise en scène est sobre et espiègle. Elle est tenue par de grands moments d'austérité, soutenue par une caméra qui se pose et qui réfléchit sur ses sujets et leur situation. Cette sobriété est courtcircuitée par des soubresauts qui jaillissent à l'écran, intenses et forts. Il n'est jamais question ici de chaos soudainement relâché, mais de maîtrise, tant l'ensemble est conduit d'une main de maître. Cette action pourtant brutale et furtive, n'est pas pour le moins lisible : sens du cadre et qualité du montage y sont pour quelque chose. Fidèle compositeur du canadien, Howard Shore trahit peut-être à quelques moments cette finesse artistique par des compositions trop "heroic-fantasy-enne", même si l'ensemble demeure équilibré et juste. Quant à l'interprétation, elle est servie par de très bons acteurs, au jeu mystérieux et ambigu, tendu mais retenu, sans jamais tomber dans l'excès. David Cronenberg prouve à nouveau (doit-il encore le faire ?) avec ce film que son cinéma est remarquable, mais surtout, il démontre qu'il est possible dans un univers hollywoodien castrateur pour un artiste, de réaliser des films conciliant habilement la "commande" et la singularité.



