Irréversible (2002) de Gaspard Noé
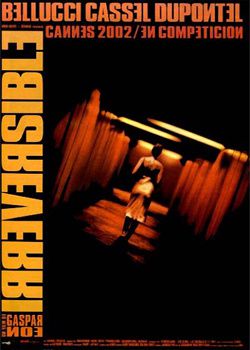 Ce qui va suivre est une critique dithyrambique. J’assume toute la subjectivité que cela
sous entend.
Ce qui va suivre est une critique dithyrambique. J’assume toute la subjectivité que cela
sous entend.
Même si Monica Bellucci est plus souvent une cruche constipée à la palette de jeu réduite à son expression la plus simpliste ; si le propos est parfois ambigu (quant à la nature et au statut de l’homosexualité) et le contenu visuel parfois « too much », le film de Gaspard Noé a tout d’un chef-d’œuvre artistique dans une époque où la censure est de plus belle, où l’art est menacé par un format tout mâché, préconçu, imposé par la sacro-sainte loi du marché dans lequel le « cinéma » est vu d’abord comme un objet de rentabilité. Alors oui, dans ce cas de figure, le travail de Noé est à marquer d’une pierre blanche. C’est un film abouti dans le sens où le metteur en scène va jusqu’au bout de ce qu’il entend, imagine dans le passage de l’esprit au tournage. Son cinéma n’est pas là pour faire des compromis, n’y faire du racolage, c’est un morceau d’art brut, libre.
Inutile de revenir ici sur tout ce qui a été dit à propos de la monstruosité, de la vengeance dépeinte de sa manière la plus abrupte, la plus crue, par un cinéaste qui refuse toute concession.
Penchons-nous davantage sur d’autres thèmes que ce très beau film comporte. Irréversible est un drame humain, et au-delà social. Ce que Noé avait déjà abordé dans ses deux précédents
métrages (Carne et Seul contre tous) ont été poussé sans doute à leur paroxysme : la violence comme exutoire des frustrations sociales, inégalitaires. La violence
qui ressort de chacun des protagonistes est celle d’un immense sentiment d’injustice dans un monde déboussolé, où les rapports sociaux sont tendus. Que ce soit Marcus, ou le Ténia, ce qui
engendre cette violence chez eux, c’est l’agression d’un certain nombre de facteurs d’inégalité sociale décuplant l’animosité, renforçant la rancœur d’un monde vu comme inéquitable, partial. Dans
ce sens, on pourrait entrevoir le viol commis par le Ténia comme une vengeance sociale, un acte ordurier contre une parvenue luxueuse et propre, rabaissée sur le sol sale d'un souterrain, au même
niveau que l'auteur du crime. Dans cet univers, les actes sont comme l'épée de Damoclès qui s'abat fatalement, à la manière de l’injustice socio-économique représentés le chômage, l’exclusion, et
la marginalité.
Sur le plan artistique, Noé est un virtuose. Il manie la caméra comme personne, s’aventure dans des expérimentations mise-en-scéniques audacieuses et percutantes. Inutile de s’acharner sur le fait qu’il n’aie pas inventé le montage « réversible » (il ne l’a jamais prétendu), mais plutôt de souligner la fluidité de l’ensemble, du sens de l’espace et du cadre. Les sublimes plans-séquences sont sans doute parmi les plus beaux jamais filmés, faisant entrer Noé dans la catégorie des grands filmeurs, à l’instar de Mikhaïl Kalatozov.
Comment ne pas saluer dans cette optique, le génie de Gaspard Noé ? Après Carne et Seul contre tous, Irréversible confirme ici que nous avons affaire à
un grand, peut-être le cinéaste français le plus doué de sa génération. Quand le talent se conjugue avec le courage et la témérité, le cinéma ne peut que mieux s’en tenir dans une époque où on le
dit « mort »…
Vidéodrome (1982) de David Cronenberg
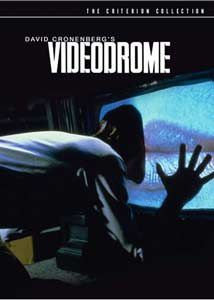 Quelle claque ! Est-ce enfoncer une porte ouverte que de dire que le film de Cronenberg
est visionnaire ? Très certainement. La télévision est ici instrument de contrôle, de manipulation; elle exerce un pouvoir magnétisant, ensorcelant sur des spectateurs qui la boivent comme
le calice de la messe. Cronenberg ne s'y trompe pas d'ailleurs, puisqu'elle est chez lui un moyen de thérapie, un lieu de confessionnal. Instrument dangereux, abrutisant qui retourne comme un
gant sa cible, quitte à lui faire dire et faire tout et son contraire (en l'occurence ici Max Renn). On pourrait en discuter sur de longues pages tant les thèmes sont riches, et la mise en scène
audacieuse. Le fim est à la mesure du petit écran : fascinant. La photographie est très belle et très détaillée, la musique d'Howard Shore toujours aussi adéquate ; ni anecodtique, ni
exhubérante, elle n'est pas là pour appuyer démesurément le film, juste pour souligner ici et là certaines séquences. Un grand film servi par des acteurs toujours aussi bien dirigés par le
canadien. James Woods est parfait en producteur télé un peu confus face à des personnages environnants tous plus éngimatiques les uns que les autres.
Quelle claque ! Est-ce enfoncer une porte ouverte que de dire que le film de Cronenberg
est visionnaire ? Très certainement. La télévision est ici instrument de contrôle, de manipulation; elle exerce un pouvoir magnétisant, ensorcelant sur des spectateurs qui la boivent comme
le calice de la messe. Cronenberg ne s'y trompe pas d'ailleurs, puisqu'elle est chez lui un moyen de thérapie, un lieu de confessionnal. Instrument dangereux, abrutisant qui retourne comme un
gant sa cible, quitte à lui faire dire et faire tout et son contraire (en l'occurence ici Max Renn). On pourrait en discuter sur de longues pages tant les thèmes sont riches, et la mise en scène
audacieuse. Le fim est à la mesure du petit écran : fascinant. La photographie est très belle et très détaillée, la musique d'Howard Shore toujours aussi adéquate ; ni anecodtique, ni
exhubérante, elle n'est pas là pour appuyer démesurément le film, juste pour souligner ici et là certaines séquences. Un grand film servi par des acteurs toujours aussi bien dirigés par le
canadien. James Woods est parfait en producteur télé un peu confus face à des personnages environnants tous plus éngimatiques les uns que les autres.
PS: A ceux qui aimeraient le découvrir, je recommande très fortement la somptueuse édition de l'éditeur new-yorkais Criterion qui rend pleinement hommage à ce film. Elle propose une très belle image, accompagnée de suppléments très intéressants le tout dans un packaging très original.
Les frères Grimm (2005) de Terry Gilliam
 Mettons tout de suite les choses au clair.
Même si le dernier film de l'ex-Monty Python sent la "coupe" à plein-nez (montage charcuté) et est victime de choix de forme et de casting parfois incongrus, tâche est de reconnaître que
l'univers créé est suffisamment inventif/débridé et décalé pour être totalement cohérent avec le reste de l'oeuvre de Terry Gilliam. Quelle mouche a pu bien piquer les critiques presse pour être
aussi sévères à son égard ? Mauvaise foi ou exigences trop poussées vis à vis du cinéaste ? Certes, le film est un divertissement piloté pour une large part par les
producteurs-castrateurs Weinstein ayant causé moult maux au metteur en scène, mais le résultat final laisse à penser -comme l'a suggéré le créateur du site Resetmag.com que nous saluons
au passage - que le réalisateur semble fonctionner dans un travail d'opposition avec son environnement socio-professionnel comme il l'a si bien démontré depuis
Mettons tout de suite les choses au clair.
Même si le dernier film de l'ex-Monty Python sent la "coupe" à plein-nez (montage charcuté) et est victime de choix de forme et de casting parfois incongrus, tâche est de reconnaître que
l'univers créé est suffisamment inventif/débridé et décalé pour être totalement cohérent avec le reste de l'oeuvre de Terry Gilliam. Quelle mouche a pu bien piquer les critiques presse pour être
aussi sévères à son égard ? Mauvaise foi ou exigences trop poussées vis à vis du cinéaste ? Certes, le film est un divertissement piloté pour une large part par les
producteurs-castrateurs Weinstein ayant causé moult maux au metteur en scène, mais le résultat final laisse à penser -comme l'a suggéré le créateur du site Resetmag.com que nous saluons
au passage - que le réalisateur semble fonctionner dans un travail d'opposition avec son environnement socio-professionnel comme il l'a si bien démontré depuis Brazil.
La mise en scène est à l'image du portrait de cet homme de main du général Delatombe (brillamment campé par Jonathan Pryce): un opéra où s'entremêlent pour le plaisir et dans le respect du conte,
clinquant, féérie, cruauté. Laissez-vous porter par tous ces plans magnifiques où la pureté plastique côtoie le baroque et le "kitsch". Si les décors ont parfois un rendu "carton-pâte", ils
participent complètement à l'aspect suranné et naïf du conte. Comment ne pas penser alors au travail de Ray Harryhausen - nous rejoignons ici le point de vue de Christian Viviani de
Positif - sur des films comme le Choc des Titans (séquence des 3 sorcières aveugles) ? Ce "bric-et-broc" visuel contribue à renforcer les clichés et le "comique"
pleinement assumés notamment par des acteurs qui surjouent en permanence. C'est pourquoi il convient de rendre à César ce qui lui appartient, de comparer le dernier film de Gilliam -même bridé-
avec ce qui est projeté chaque semaine sur nos écrans. Si les Frères Grimm n'est pas le chef-d'oeuvre de son auteur, son univers bariolé et incroyablement beau représente sans doute
l'aboutissement du conte à l'écran. Il distille un plaisir qui nous renvoit directement aux Aventures du baron de Münchausen. Malgré quelques "tocs" (que nous pensons assumés), le
spectacle offert ici en vaut la peine : yeux écarquillés d'émerveillement et sourire radieux garantis !
Rocketeer (1991) de Joe Johnston
 Rocketeer est ce que l'on pourrait appelé un film castré, ou pour utiliser un
terme quelque peu galvaudé, "malade". Si ce n'est pas un mauvais film en soi (le fond scénaristique et le ton sont fidèles à l'esprit de la bande dessinée), les choix formels sont très
discutables. En effet, la mise en scène de Joe Johnston est tout sauf audacieuse, si bien que le film manque continuellement d'ambition, d'une corpulence qui aurait pu le sortir de la monotonie
visuelle hollywoodienne. Le Monsieur n'insuffle à aucun moment de personnalité à son oeuvre, si bien qu'à de nombreux instants, on serait tenté de crier: "merde, s'il avait fait comme ça... ça
aurait pu donner ça..." Cette fadeur se retrouve un peu dans le casting et la figure de Howard Hugues, personnage consensuel qui mériterait un traitement un brin plus excessif, tourmenté. Timothy
Dalton, qui sert habilement la figure aventuresque emblématique Erol Flynienne demeure désespérement seul à jouer avec autant d'énergie. La musique ennuyeuse ou barbante (au choix) couronne un
ensemble désespérement tristounet. C'est une déception au final, même si tout n'est pas vilain ; l'univers des années 30'' est plutôt joli, un peu dans la même tonalité du
Rocketeer est ce que l'on pourrait appelé un film castré, ou pour utiliser un
terme quelque peu galvaudé, "malade". Si ce n'est pas un mauvais film en soi (le fond scénaristique et le ton sont fidèles à l'esprit de la bande dessinée), les choix formels sont très
discutables. En effet, la mise en scène de Joe Johnston est tout sauf audacieuse, si bien que le film manque continuellement d'ambition, d'une corpulence qui aurait pu le sortir de la monotonie
visuelle hollywoodienne. Le Monsieur n'insuffle à aucun moment de personnalité à son oeuvre, si bien qu'à de nombreux instants, on serait tenté de crier: "merde, s'il avait fait comme ça... ça
aurait pu donner ça..." Cette fadeur se retrouve un peu dans le casting et la figure de Howard Hugues, personnage consensuel qui mériterait un traitement un brin plus excessif, tourmenté. Timothy
Dalton, qui sert habilement la figure aventuresque emblématique Erol Flynienne demeure désespérement seul à jouer avec autant d'énergie. La musique ennuyeuse ou barbante (au choix) couronne un
ensemble désespérement tristounet. C'est une déception au final, même si tout n'est pas vilain ; l'univers des années 30'' est plutôt joli, un peu dans la même tonalité du Dick
Tracy de Warren Beatty sorti en 1990, dont le film fait drôlement écho. Dommage que Rocketeer ne soit qu'un Blockbuster gentillet, trop carré, et qu'il manque d'un zeste de folie
mise-en-scénique qui aurait pu donner un film mémorable sinon cossu.
Massacre à la tronçonneuse (1974) de Tobe Hooper
 Massacre à la tronçonneuse n'a
Massacre à la tronçonneuse n'a
Tobe Hooper aurait commencé son apprentissage cinématographique en jouant avec la caméra de ses parents (une Super 8) alors qu'il avait 3 ans. Autant dire que cela se voit ! Pour son second film, Tobe Hooper donne le "la" : chaque plan étant une leçon de cadrage, de découpage de l'espace visuel, le tout avec un grand sens du détail et de la précision. Aidé d'une mise en scène qui allie la viscéralité au "documentaire", le film est un pur concentré de tension éprouvante, où la mort n'est pas un acte facile. Le négatif (16mm contre les 35mm habituels) et la photographie de Daniel Pearl contribuent fortement à cette atmopshère poisseuse. Tantôt écrasante et brûlante (on transpire avec les acteurs sous ce soleil texan), elle sait se faire rouge brun lorsque l'ambiance le suggère. Car il s'agit bien de la grande qualité artistique du film, de son haut pouvoir suggestif ; En effet, Hooper a raison lorsqu'il annonce que "notre imagination dépasse tout ce qu'il peut montrer à l'écran". Il faut donc travailler en ce sens, aider le spectateur à créer lui-même ses émotions, à frémir "en direct" avec les protagonistes. La musique composée par le réalisateur en personne, est un ensemble de bruits, de sons collés ici et là pour souligner un acte, offrir aux acteurs toute la démesure de leur folie : Ed Neal en "auto-stoppeur" est en ce sens, un modèle. The texas chainsaw massacre (titre original) a tout d'un grand film d'effroi. Il sacre dès le premier tour, le talent d'un grand cinéaste. Il sondera de nouveau la folie de l'homme dans un autre film majeur, Le crocodile de la mort où l'on retrouve un autre acteur de talent : Robert Englund, A.K.A Freddy.
Last Action hero (1993) de John McTiernan

Les indestructibles (2004) de Brad Bird
 Allier le divertissement infantile tout en suscitant l'intérêt des plus grands est
loin d'être un pari gagné d'avance ! Et pourtant, Monsieur Brad Bird (Le géant de fer) nous a encore étonné ! Bravo !
Allier le divertissement infantile tout en suscitant l'intérêt des plus grands est
loin d'être un pari gagné d'avance ! Et pourtant, Monsieur Brad Bird (Le géant de fer) nous a encore étonné ! Bravo !
Non content d'être le film d'action le plus ébouriffant de l'année, Les indestructibles) nous offre une vision de la société et de la famille "occidentale" enfin actualisée ! Il n'est pas question ici de prince charmant héroïque, marié uniquement pour le meilleur, apportant bonheur et amour infinis à la gentille princesse dans un monde fantasmé (Qui a pensé à la chanson douce-amère du groupe Téléphone ?). Non ici, dans le monde de ces supers héros comme dans la vraie réalité (sic), l'histoire ne finit pas là où elle devrait commencer : le mariage et les promesses initiales ne scellent en rien la réussite du couple. Sa solidité se construit en binome, avec un réel travail d'écoute et de tolérance. C'est pourquoi le scénariste-réalisteur a pensé à brosser un portrait moins daté et grossier, et a choisi les nuances pour aborder les thèmes de la vie quotidienne. Il n'est pas étonnant alors de parler d'un père de famille traversant la crise de la quarantaine ou de celle d'une jeune adolescente dont la recherche d'identité passe par le port d'une tenue différente (mèche de cheveux). La morale (que serait un dessin animé sans elle ?) est intéressante tant elle renvoie à ce qui fait défaut chez chacun d'entre-nous : un esprit d'équipe et une cohérence de l'ensemble pour résoudre les difficultés. Sur le plan visuel, rien à redire (ce serait vraiment mesquin) devant tant de maîtrise graphique ! Les dernières technologies utilisées par les studios Pixar offrent un rendu des plus impressionnants, servant un scénario alambiqué et inventif, digne de la saga James Bond. Du cinéma divertissant et intelligent comme ça, on en redemande !
Dommage collateral (2002) de Andrew Davis
 Fidèle à sa tradition de "télé-poubelle", la chaîne qui "vend du temps de
cerveau disponible" (dixit son directeur de programmation) nous a servi une nouvelle soupe cinématographique en ce beau dimanche du mois de septembre.
Fidèle à sa tradition de "télé-poubelle", la chaîne qui "vend du temps de
cerveau disponible" (dixit son directeur de programmation) nous a servi une nouvelle soupe cinématographique en ce beau dimanche du mois de septembre.
Alors qu'il nous avait plutôt séduit avec Meutre parfait, remake élégant du Crime était presque parfait de Sir Alfred H., Andrew Davis est retombé bien bas avec cet avorton. Film post-11 septembre - on l'aura compris en lisant le pitch -, Dommage collatera nous narre l'histoire d'un "gentil-tout-plein" sapeur-pompier californien ayant perdu femme et fils à cause d'un (très) méchant terroriste colombien, qu'il convient bien entendu, d'éliminer à tout prix. Grrr ! Remplacez les visages et les noms et vous aurez là un parfait petit film de propagande bushienne. Scénario débilisant avec acteurs de légende (sic) le tout dans une mise en scène lisse et ultra-codée (ralentis, plans rapprochés sur actes de bravoure, etc.) : voilà pour le plan "artistique". Non, rien ne parvient à sauver le bateau du naufrage, pas même la vilaine photographie de Adam Greenberg. Si l'on est pas surpris de retrouver "Gouvernator" devant la caméra, on demeure plus dubitatif devant l'apparition de John Turturro. Qu'est-ce que ce grand acteur est venu faire dans cette galère grotesque ? Certains diront justement "qu'il faut mettre du beurre dans les épinards", mais tout de même !
Inutile d'insister plus lourdement devant tant de lourdeur et de gaucherie à l'écran. Annoncé par les programmes comme "inédit en clair", on aurait bien aimé finalement qu'il le demeure. Mais le pire reste à venir : cette fameuse chaîne de qualité (sic) risque de nous le rediffuser à l'occasion, histoire de prendre définitivement ses spectateurs pour des abrutis. Facilité quand tu nous tiens...
Virgin suicides (1999) de Sofia Coppola

Un regard émouvant et sensible sur l'adolescence, ses émois, ses incompréhensions sur les thèmes de la vie baignée dans un environnement social complexe. Derrière ce fragment de vie au parfum rétro (renforcé par les teintes sépia de la photographie), c'est un drame social - sociétal ? - qui se déroule sous nos yeux, dépeint de manière subtile. Rares sont les films où la musique tend à dire/souligner aussi fortement le point de vue du cinéaste ; la BO de Air est "aérienne", en parfaite adéquation avec les images surréalistes, en apesanteur un peu comme les objets chez Magritte. On en retient un film surprenant et déroutant où chacun a sa place, son mot à dire, même le plus anodin. Une oeuvre qui annonce le talent (confirmé par Lost in translation) d'une grande cinéaste en devenir.
Broken Flowers (2005)de Jim Jarmusch
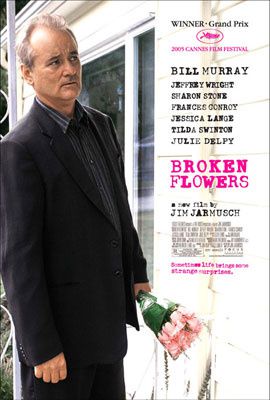 Dire que le nouveau métrage de Jim Jarmusch était attendu par les cinéphiles serait
un euphémisme tant la réputation du Monsieur est importante et le casting prometteur. En effet, que peut-on demander de mieux que la réunion du zen jarmuschien avec la coqueluche actuelle des
cinéphiles : Bill Murray ? Donné favori pour décrocher la palme, Broken flowersn'est reparti "qu'avec" le Grand prix. Ce résultat a fait l'objet d'un grand nombre de débats,
certains justifiant cette récompense par la légèreté apparente de cette comédie douce-amère, le ton quelque peu décalé de ce film mélancolique. Et pourtant...
Dire que le nouveau métrage de Jim Jarmusch était attendu par les cinéphiles serait
un euphémisme tant la réputation du Monsieur est importante et le casting prometteur. En effet, que peut-on demander de mieux que la réunion du zen jarmuschien avec la coqueluche actuelle des
cinéphiles : Bill Murray ? Donné favori pour décrocher la palme, Broken flowersn'est reparti "qu'avec" le Grand prix. Ce résultat a fait l'objet d'un grand nombre de débats,
certains justifiant cette récompense par la légèreté apparente de cette comédie douce-amère, le ton quelque peu décalé de ce film mélancolique. Et pourtant...
C'est donc avec un plaisir non dissimulé (coupable ?) que l'on suit les tribulations de Don Johnston (avec un T s'il vous plaît) - quinquagénaire rentier d'une société d'informatique flamboyante - parti à la recherche de la mère d'un probable fils qu'il n'a jamais rencontré... Personnage énigmatique et lassé d'une vie fade, Don est l'archétype du yuppie US confrontée à une réalité qu'il a longtemps évité ou ignoré faute d'un vie professionnelle épanouie mais envahissante, de relations sentimentales nombreuses mais fragiles.
Au-delà des quelques traits ironiques en surface de cette fausse-comédie, Jim Jarmusch pose dans chaque plan une question essentielle : la course à l'efficacité et la réussite fait-elle oublier (perdre ?) le vrai sens de la vie, de ses valeurs ? Des gadgets électroniques devenus futiles pour nos vies (ouverture du film) aux symboles de la méritocratie américaine (Gigantesques demeures des quartiers résidentiels, pendentif "money", etc.) les séquences sont remplies de détails, de symboles d'une société consumériste déboussolée, en quête d'une certaine clarification, d'une nouvelle dimension dans laquelle elle pourrait évoluer.
Le monde qui s'offre aux yeux de Don est à la fois stéréotypé et décalé ; un univers étrange, incompréhensible qui échappe à un personnage blasé. Est-ce la lucidité et l'expérience d'un homme désabusé qui explique cette lassitude, ou l'ennui d'une vie finalement creuse, qui lui empêche d'être actif, de se battre ? (cf. Nous renvoyons pour cela au très original Monique de Valérie Guignabodet et à ses dialogues croustillants)
Toutes ces questions n'auraient de sens sans le talent d'un Grand. Oui, Bill Murray est un Grand. Ce truisme apparent ne sera jamais assez répété tant l'acteur est doué. Cet ancien comique
(Ghostbuster) est en passe de devenir l'un des personnages cinématographiques les plus mélancoliques de toute l'histoire du cinéma (Les récents Lost in Translation de Soffia
Coppola et La vie auqatique de Wes Anderson l'ont confirmé). Son faciès dégage un quelque chose d'inexplicable, un semblant de désarroi trahi par ses yeux, ce regard posé sur le vide, à
la recherche d'une source d'attraction. A cela, ajouter une mise en scène sobre et touchante (comme pour Dead Man) où la caméra se fait délicate, aidée dans ses pauses par des fondus qui
renforcent l'atmopshère lénifiante distillée tout au long de ce road-movie existentiel, ce chemin parcouru par un père cherchant à transmettre quelque chose à un fils dont il ne s'est jamais
lui-même appliqué, à parler de la vie et de ses valeurs qu'il n'a probablement jamais saisi.
Les âmes grises (2005) de Philippe Claudel
 Si les dernières productions cinématographiques de ce mois se sont caractérisées par
l'emphase et le clinquant (Qui a dit The Island ?), le film de Yves Angelo se distingue par la sobriété et la délicatesse. C'est l'histoire de la mort, qui se présente au premier abord
dans ce faux film policier. Celle qui frappe les milliers de soldats sur le front ouest de la Grande Guerre, celle qui contamine aussi l'esprit et le quotidien de toute une société villageoise
qui vit repliée dans l'espoir de retrouver les siens, dans la quête d'une hypothétique fluidité sociale qui caractérisait le milieu avant guerre.
Si les dernières productions cinématographiques de ce mois se sont caractérisées par
l'emphase et le clinquant (Qui a dit The Island ?), le film de Yves Angelo se distingue par la sobriété et la délicatesse. C'est l'histoire de la mort, qui se présente au premier abord
dans ce faux film policier. Celle qui frappe les milliers de soldats sur le front ouest de la Grande Guerre, celle qui contamine aussi l'esprit et le quotidien de toute une société villageoise
qui vit repliée dans l'espoir de retrouver les siens, dans la quête d'une hypothétique fluidité sociale qui caractérisait le milieu avant guerre.
Désillusion ? Très certainement. Le film nous brosse un portrait relativement fidèle de la société française du début XXe siècle - et c'est là sa seconde qualité, où les classes sociales s'entrechoquent (cf. audition du juge et de la "récupératrice"), et dans lesquelles les différents groupes sociaux cultivent une phase de repli. C'est dans cette phase de crispation où les élites pratiquent ce qu'on appelle la défense du corps, et où chacun entretient désespérément son habitus (protection des traditions, de ses habitudes culturelles, sociales, Cf. Myerck) que les protagonistes s'isolent (le procureur) pour mieux fuir les nouvelles réalités sociales à venir (bouleversement social né de la guerre où les anciennes élites aristocratiques sont frappés durement).
Pour nous peindre de façon réaliste ce microcosme rural, le cinéaste a choisi une mise en scène académique où la caméra se fait douce et carressante, de manière à se pencher au plus près du vécu des différents acteurs. Rien ne serait efficace sans la direction exemplaire d'acteurs de talent : d'un côté, un procureur campé par un Jean-Pierre Marielle impérial, au personnage légèrement cambré (le poids du temps), reflétant tristesse et désarroi ; de l'autre, un magistrat inique et cynique, condescendant et détestable, interprété merveilleusement par Jacques Villeret. La photographie quant à elle, est en parfaite adéquation avec le point de vue ; elle sait se faire pluvieuse et brumeuse, tout en se étant très lumineuse sur les visages des acteurs, de sorte que la tête, l'esprit (la force des hommes) sont détachés pour mieux mettre en valeur ce qui importe dans cette histoire : le poids des mots.
De ce film fort et froid, on en retient un grand moment d'humanité, une étude pointilleuse du genre humain dans ses phases les plus extrêmes et contradictoires (de l'amour à la haine, de la violence à l'espoir) mais complémentaires, ces mêmes passages transitoires qui justifient le beau titre du roman de Philippe Claudel et du film de Yves Angelo.
Gozu (2003) de Takashi Miike
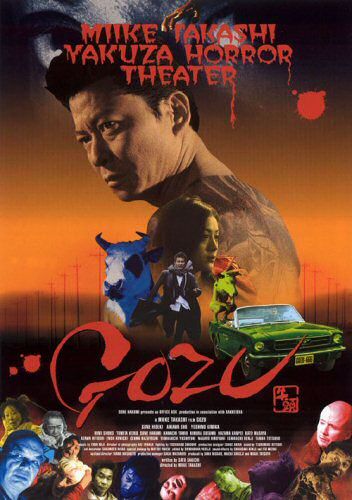
Découvrir un film de Takashi Miike est toujours un plaisir - curieux, malsain (comme vous préfèrez) - tant le réalisateur est imprévisible et capable de tout. Il est intéressant à juste titre,
car il demeure parmi les rares cinéastes notoires à s'aventurer dans des domaines insolites, dont il a lui seul le raison et le secret. On connaît le metteur en scène de l'ultra-violence
(Dead or Alive, Ichi the Killer) ; avec Gozu, nous voici en présence d'un Miike "lynchien" qui nous raconte une histoire de yakusas dans une atmopshère
lancinante, oscillant en permanence entre fascination et dégoût. Si le film est regorgé de surprises visuelles de taille (dont une ouverture et un final complètement déjantés), l'histoire manque
néanmoins de tension dramatique. Comme à l'accoutumée chez le réalisateur nippon, le film a des problèmes de rythme; les longs plans-séquences qui s'enchaînent ont parfois fonction de somnifère.
Si les acteurs sont convaincants et la photographie plutôt réussie (dans son caractère ocre), l'ensemble demeure plutôt inégal et laisse un arrière-goût de déception, voire de frustration quand
on connaît les capacités de l'auteur. On en retiendra un film curieux, au climat envoûtant pour un public averti.
Chiens enragés (1949) de Akira Kurosawa

Que dire devant autant de maîtrise formelle et scénaristique ! C'est sidérant.
Une grosse claque, une leçon de cinéma dont certains metteurs en scène de téléfilms policiers racolleurs et consensuels devraient prendre de la graine. Aucune facilité, aucune séduction trompeuse du spectateur dans ce polar noir de Kurosawa qui allie l'écriture et l'atmosphère de Georges Simenon, la tension et la sobriété que l'on retrouvera dans le cinéma de Jean-Pierre Melville (Le samouraï, le Cercle rouge). Chien enragé, ce sont les tribulations d'un flic tendu brillamment interprété par Toshiro Mifune, et sa rencontre avec le commissaire Sâto campé par Takashi Shimura, dont le personnage a tout du Maigret simenonien. Kurosawa ne s'en cache pas d'ailleurs, les clins d'oeil et les références abondent (porte cigarette, regard désabusé sur le monde, sagesse, lucidité, écoute, contact social, absence de méthode précise d'investigation...). Le cadrage est parfait, les plans en plongée et les fondus sont à couper le souffle. Rien à redire, tout est maîtrisé, du plan d'ouverture jusqu'à la dernière séquence qui laisse sans voix. Au final, un film superbe, fort et oppressif, un chef-d'oeuvre tout simplement.
Alexandre (2005) de Oliver Stone
 Fidèle, superbe et épique.
Fidèle, superbe et épique.
Voilà les premiers mots qui me viennent à l'esprit après visionnage du dernier long-métrage de Stone. Et dire que j'avais énormément de préjugés, qui au final, se sont dissipées au fin fond du puits cérébral de toutes mes idées préconçues infondées.
D'abord sur le plan historique (cela me concerne tout particulièrement - certains d'entre vous me comprendront ;) ). Et bien, rien à redire (ou presque), tout colle presque parfaitement. Hormis quelques détails tocs (phare d'Alexandrie, tour de Babel, cartes ô combien trop détaillées, décors babyloniens sortis tout droit de l'imaginaire d'Hollywood), le conseiller historique a été écouté attentivement, et cela fait plaisir. Stone nous délivre un Alexandre conforme aux dernières interprétations des antiquisants, notamment des travaux de Pierre Briant ou de John Mâ. De l'adolescence et l'éducation aristotélicienne qui dispense au jeune macédonien le goût pour l'oecuménisme et lui enseigne la dimension universelle de la culture, jusqu'aux fondations des cités grecques balisant cet immense territoire ayant pour but de disséminer la civilisation hellénistique en passant par la consultation de l'oracle d'Ammon-Zeus dans l'oasis de Siwah lui confirmant son ascendance divine et sa prédestinée universelle, tout y est ou presque. Car il s'agit bien de cela, d'un personnage mi-dieu, mi-homme qui fascine ces contemporains. Le geste d'Alexandre, trancher par le fer (noeud gordien) et fonder des cités est emblématique et fort : ces successeurs, les Diadoques et leurs descendants reprendront à leur compte ce projet culturel. Les ô combien récalcitrants généraux d'Alexandre, Antigone le Borgne, Séleucos, Lysimaque en tête, qui s'offensent que les barbares reçoivent la "dignité" grecque seront les premiers à imiter le geste de leur "aïeul" souverain. La fidélité du cinéaste est telle que des répliques entières prononcées par Colin Farell et Val Kilmer sont issues avec exactitude de Plutarque et de sa Vie d'Alexandre. Les batailles sont quant à elles très inspirées; déplacements, confrontations, manoeuvres : la représentation de la phalange doit se rapprocher sensiblement de la réalité historique. Selon les dires de Stone, le montage originel approchait les 5 heures, je serais curieux de savoir quels autres morceaux de la vie d'Alexandre il avait ajouté.
Et sur le plan artistique ? Excepté quelques tics de jeu d'acteur (Angelina Jolie), d'accompagnement musical (la BO a tendance a trop sur-signifier l'action ou le propos), ou de choix visuel (filtre rouge incongru), la mise en scène est clinquante, brutale, tendue. Les batailles sont incroyablement bien filmées et gérées, les confrontations sont particulièrement sanglantes et sauvages. Comment rester insensible à la photographie merveilleuse de Rodrigo Prieto, qui unie admirablement la chaleur écrasante des déserts irakiens et la noirceur de la nuit mystérieuse des palais de Pella ou de Babylone ? Visages et décors sont stupéfiants de détails, même dans les pires conditions de lumière. Bravo. Enfin que dire de l'effet visuel global, de ces plans de folie qui marquent à tout jamais votre expérience de cinéphile (travelling sur Alexandre avant la bataille de Gaugamèle, confrontation éléphantesque...) ? Tout est léché, plastiquement irréprochable. (je pense particulièrement aux plans alexandrins).
Bref, c'est du grand cinéma, du grand spectacle réfléchi, consistant, aux antipodes de certains spectacles "péplumesques" hypocrites et abrutis, anachroniques et racoleurs. Il y a quelquechose dans ce film et dans la façon de le concevoir, de le peaufiner qui nous fait aimer le cinéma et qui nous rassure quant à son avenir.



